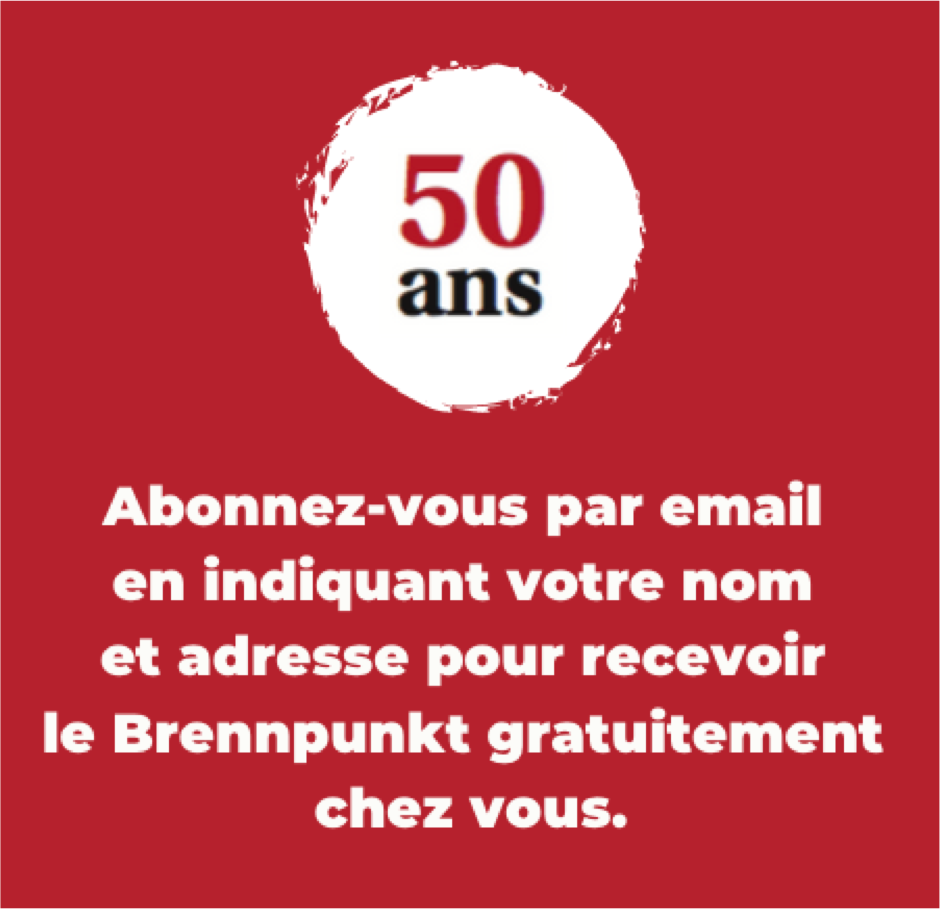Par « santé globale », on entend habituellement un cadre d’action collective, transcendant les frontières nationales pour lutter contre les inégalités sanitaires. Pourtant, cet idéal souvent brandi dans les enceintes internationales masque une réalité plus complexe et conflictuelle. Derrière la rhétorique universelle se cache fréquemment une logique descendante : des solutions conçues ailleurs, imposées parfois maladroitement à des contextes locaux profondément divers.
Ce numéro entend rompre avec ce paradigme dominant. À travers une série de contributions éclairantes, il explore non seulement les promesses, mais aussi les fractures du concept de santé globale. De Salvador aux centres de décisions des bailleurs de fonds, en passant par le continent africain et les Philippines, nos auteur·ice·s dévoilent les tensions entre stratégies internationales et besoins locaux, entre urgences politiques et souveraineté sanitaire, entre discours et pratique.
Un premier article, signé par Dr Kpalma Duga Bakpatina-Batako et Titipo Simbré, plaide pour un changement de cap : sortir du pilotage vertical des programmes pour adopter ce qu’ils appellent un « bricolage intelligent », ancré dans les savoirs et coutumes locales — une approche nécessaire pour une santé qui soigne vraiment.
L’expérience salvadorienne, présentée dans la contribution de Raymond Wagener, illustre parfaitement cette dynamique : là, où l’accès aux soins est limité, c’est la créativité et la flexibilité communautaires qui deviennent des leviers d’avenir.
À ces questions méthodologiques s’ajoute le désengagement progressif — parfois brutal — notamment avec le retrait massif de l’aide américaine (USAID), un acteur clé du financement mondial de la santé. La baisse des financements, la volatilité des priorités et la redirection des aides vers des objectifs géostratégiques menacent directement les ambitions mêmes de la santé globale.
Kayla de Quiroz interroge ces logiques d’aide : loin d’être neutres, elles s’inscrivent dans des cadres politiques influencés par des intérêts géopolitiques, économiques, voire idéologiques, éloignant l’aide de son but premier — améliorer durablement la santé des populations.
De son côté, Médecins Sans Frontières tire la sonnette d’alarme : « une inquiétante érosion des engagements envers des programmes de santé structurels et de long terme » fragilise les systèmes existants. Face à « l’urgence devenue mode par défaut », ils mettent en garde contre un désistement qui pourrait précipiter l’effondrement de structures déjà fragilisées, abandonnant les populations les plus vulnérables.
Or, comment garantir la pérennité des systèmes de santé dans ce climat d’incertitude ? C’est à cette interrogation que Raymond Wagener s’attèle dans la dernière partie de ce dossier, en esquissant des pistes pour un futur plus stable et équitable.
Ce numéro ne prétend pas à l’exhaustivité. Il laisse en creux certains enjeux majeurs — du nexus santé-climat à la propriété intellectuelle —, mais pose les jalons d’une réflexion collective sur l’articulation entre action globale et pertinence locale, entre coordination internationale et justice sociale. Une invitation à réinventer ensemble les contours d’une santé globale véritablement partagée.