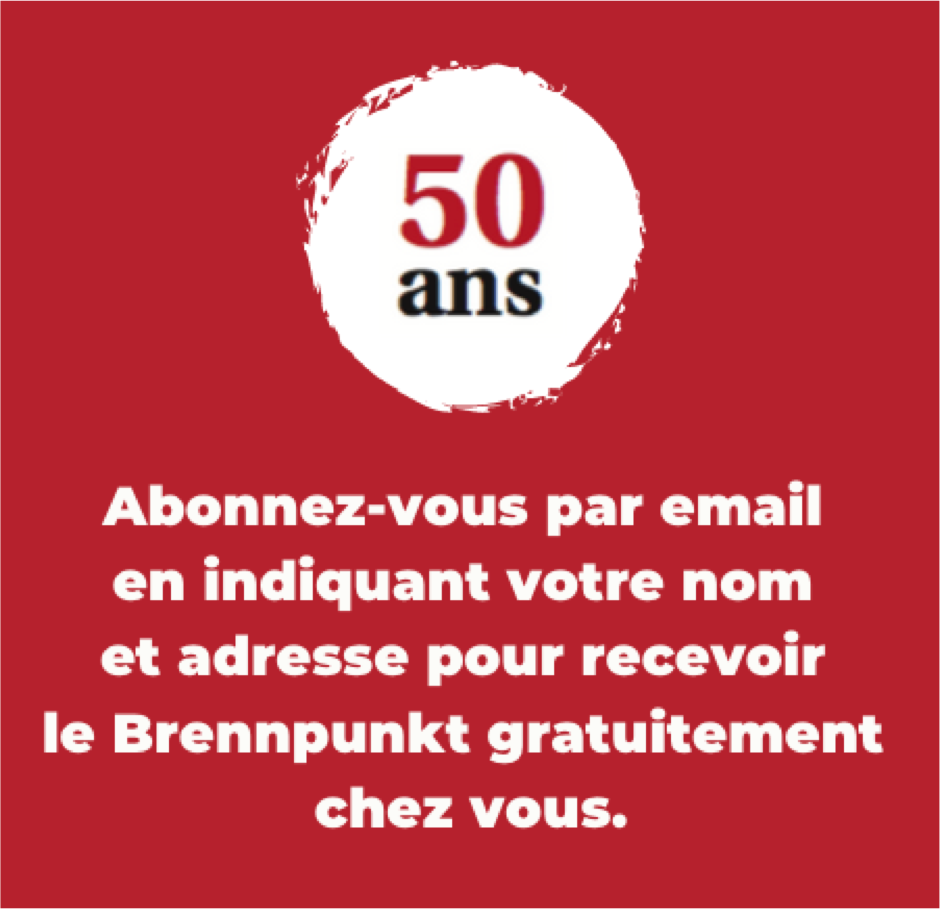Ce n’est pas un concept, c’est une bataille
Le concept de Global Health (santé globale) « consiste à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour les populations et les communautés vulnérables du monde entier ».1 Le souci majeur avec la globalité réside dans l’ensemble des interprétations dont elle peut faire l’objet. La santé globale, loin de se limiter à des normes institutionnelles, se réfère à la définition même de la santé au plan individuel : « un état de complet bien-être ».2 C’est cette approche holistique individuelle qui doit essaimer sur le plan structurel de nos pays.
« Ce concept repose en effet sur des revendications de justice sociale, partant du constat que la santé est un bien mondial, dans un contexte de mondialisation où les normes et politiques sanitaires diffèrent selon les États ».3
La Global Health, concept au cœur des actions de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 1993, est évoquée dans des rapports, conférences, plans stratégiques, … Il est devenu à la mode, presque trop. Et pourtant, quand on prend le temps de regarder au « ras du sol », dans un centre de soins de brousse, une mutuelle de santé communautaire en zone rurale, un bureau d’ONG au bord d’un marché poussiéreux – on comprend vite que la « santé globale » ne se décrète pas. Elle se vit, elle se subit parfois, elle se construit à tâtons, dans des réalités concrètes, dures, mouvantes.
Le biais des financements
La Global Health, en Afrique, est d’abord entrée par les poches. Pas celles des populations, évidemment, mais celles des bailleurs. Il faut le dire sans détour : la majorité des systèmes de santé africains, pendant deux décennies, ont été restructurés au rythme des financements internationaux. On a vu apparaître des centres flambant neufs, des campagnes de vaccination massives, des cargaisons d’antirétroviraux. Mais à quel prix ?
Le pilotage vertical des programmes – VIH, tuberculose, paludisme – a laissé des trous béants dans le tissu communautaire. Les structures locales, parfois déjà fragiles, se sont vues dépossédées de leur légitimité. On ne négociait plus les stratégies, on remplissait des indicateurs. On ne prenait plus le temps de comprendre les logiques de soins locales, on imposait des standards. Résultat : une médecine qui soigne peut être mieux certaines maladies, mais qui soigne moins bien les gens.
Au bénéfice ou à la contrainte ?
Mais l’Afrique n’a pas courbé l’échine. Ou du moins, pas partout, pas tout le temps. Sur le terrain, une autre logique s’est installée, plus discrète, mais tenace : celle du « bricolage intelligent ». Des États, des ONG, des professionnels ont commencé à contextualiser ce qu’on leur proposait. Ils n’ont pas forcément dit non, mais ils ont transformé. Ce qu’on appelait « modèle », ils l’ont transformé en « base de négociation ». Ce qu’on imposait comme « solution », ils l’ont inséré dans un contexte, en tenant compte des chefs traditionnels, des matrones, des habitudes de soins, des croyances, des ressources existantes.
Dans certaines zones, les campagnes de sensibilisation sont menées à la fois en français, en langue locale, et en récits traditionnels. Ce n’est pas de la résistance frontale. C’est plus subtil que ça. C’est une forme de réappropriation. Une manière de dire : « On prend ce que vous proposez, mais on le met à notre sauce. Parce que sinon, ça ne marchera pas. »
Entre les discours de sommet et les urgences de terrain, un gouffre
Ce que les textes ne disent jamais, ou si mal, c’est cette fracture entre ce qui se discute dans les capitales et ce qui se vit dans les périphéries. On peut bien aligner les politiques sur les cadres de l’OMS, signer tous les partenariats, adopter tous les acronymes à la mode mais dans les villages reculés, les centres sont vides, les médicaments et le matériel manquent, les soignants sont épuisés, les patients ne viennent plus – ou trop tard.
Et pourtant, c’est là, précisément là, que se joue la santé, pas sur les diapositives. Son terrain se délimite vaguement entre les gestes quotidiens, les hésitations d’une mère devant le prix d’une consultation, le regard du soignant devant un patient qu’il sait incapable de pouvoir honorer une ordonnance, la décision d’un chef de famille d’amener ou non sa fille chez le médecin, la peur, voire même le refus d’une référence à un niveau supérieur pour une bonne prise en charge en raison de la distance à parcourir et où d’une facture imaginaire déjà trop élevée, les traitements hasardeux administrés aux patients par un personnel non qualifié ou simplement en l’absence de matériel permettant de poser un bon diagnostic, etc.
Le concept de One Health qui circule aujourd’hui – intégrant l’humain, l’animal, l’environnement – peut sembler séduisant. Toutefois, il reste trop souvent confiné aux colloques. Rarement, il se matérialise sous la forme d’une collaboration concrète entre un vétérinaire, un agent sanitaire, un professionnel de la protection de l’environnement et un éleveur ou un agriculteur. Pourtant, c’est exactement ce dont on aurait besoin.
Une lueur de coordination continentale… mais encore fragile
Parallèlement à ces dynamiques locales, plusieurs initiatives institutionnelles à l’échelle régionale ou continentale témoignent d’une volonté croissante des États africains de structurer une réponse collective, coordonnée et autonome aux enjeux de santé. La création de l’African Medicines Agency (AMA), portée par l’Union africaine et entrée en vigueur en 2021, représente un tournant stratégique dans la régulation pharmaceutique. Elle vise à harmoniser les cadres nationaux, à sécuriser l’approvisionnement en médicaments essentiels et à renforcer la lutte contre les produits médicaux falsifiés, qui représentent encore une part alarmante du marché dans de nombreux pays africains.
De son côté, l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS/WAHO), bras sanitaire de la CEDEAO, joue depuis plusieurs années un rôle clé dans la surveillance épidémiologique transfrontalière, la coordination des réponses aux crises sanitaires régionales, et dans le soutien aux politiques nationales de santé reproductive, maternelle et communautaire.

Enfin, le lancement en 2023 du New Public Health Order par l’Union africaine, en lien avec le Centre africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC Afrique), marque une ambition politique claire de réorienter la santé publique africaine autour de quatre piliers : la production locale de médicaments et de vaccins, l’investissement dans les ressources humaines en santé, la gouvernance continentale, et le développement d’un partenariat plus équitable avec les institutions internationales. Ces initiatives, encore en consolidation, traduisent une volonté affirmée de passer d’une intégration subie à une souveraineté assumée en matière de santé, même si elles demeurent largement conditionnées à des équilibres géopolitiques et économiques instables.
Le problème est que toutes ces ambitions restent suspendues à un fil : celui du financement. Et tant que le cordon de la bourse sera tenu ailleurs, ces projets avanceront à cloche-pied.
Des initiatives innovantes au cœur des marges
En Afrique se développent des mutuelles de santé communautaires qui incarnent une approche décentralisée de la santé globale avec un fort ancrage local. Pas avec des modèles préfabriqués, mais avec une approche sensible, ancrée, patiente.
Au Togo, dans la région de la Kara, un programme de formation des guérisseurs traditionnels 4 a été mis en place pour les éduquer à référer les patients aux centres de soins primaires. Étant parmi les premiers recours des populations, et quand bien même ils ne sont pas associés à la médecine moderne, cette approche permet d’assoir la toile des intervenants en santé tel que le préconise la Global Health.
Au Bénin, dans le département de l’Atacora, l’ONG belge Louvain Coopération a accompagné la création de mutuelles de santé communautaires qui se sont articulées à des réseaux de femmes rurales engagées dans la gestion de la santé maternelle et infantile. L’Initiative « Femme pour Femme » mise en place par la Zone Sanitaire Tanguiéta-Cobly-Matéri, encourage toutes les femmes venant en consultation prénatale à payer une contribution de 200 FCFA (0,30€) afin de constituer une caisse de solidarité qui permet de prendre en charge le transport en cas de référence pour un accouchement compliqué. La mutuelle vient quant à elle en appui pour la prise en charge financière des coûts liés aux accouchements, qu’ils soient simples ou compliqués. Ce modèle, fondé sur la solidarité locale et la gestion participative, a permis une augmentation du recours aux soins dans des zones pauvres et historiquement sous-desservies. Au-delà des chiffres, il s’agit d’un réinvestissement du politique par les usagers eux-mêmes, qui reprennent une part d’initiative dans l’organisation des soins.
Vers une redéfinition de la santé globale
Ce texte ne plaide ni pour le rejet, ni pour la simple adoption. Il plaide pour une ré appropriation. Pour une santé globale qui ne soit pas seulement un nouveau mot pour dire « coopération internationale », mais une occasion de faire autrement. Faire avec ce que nous sommes. Avec nos histoires, nos savoirs, nos contraintes, nos forces.
L’Afrique n’a pas à entrer dans la Global Health comme dans un moule. Elle peut en redessiner les contours, en poser les conditions. Non pas pour faire « comme les autres », mais pour faire mieux – pour elle. Le Nigeria n’a-t-il pas lancé courant mai 2025 une initiative stratégique en matière de phyto-médecine afin de diversifier l’économie tout en faisant progresser l’innovation et la prestation des soins dans le pays ? 5 Cette initiative vise la libération du potentiel thérapeutique de la riche biodiversité du Nigeria par le biais de la phytothérapie et l’intégration de la médecine traditionnelle dans les structures formelles de l’économie et de la santé.
En conclusion, ce n’est pas d’un modèle universel dont nous avons besoin, mais d’un monde où chaque territoire a le droit d’inventer sa propre manière de guérir.
Bibliographie
¹ What is Global Health?, Duke Global Health Institute, consulté en mai 2025. https://globalhealth.duke.edu/what-global-health
² Organisation mondiale de la santé “Constitution de l’OMS”, consulté en mai 2025. https://www.who.int/fr/about/governance/constitution.
³ Marie-Laure Privat, “One Health, Eco Health, Global Health et Planetary Health : Quelles différences ?,” One Health Pharma, 4 juillet 2022, consulté en mai 2025. https://onehealthpharma.net/one-health-eco-health-global-health-et-planetary-health-quelles-differences/.
4 Santé intégrée forme des guérisseurs traditionnels dans le district de la Binah., Integrate Health, 4 novembre 2021, consulté en mai 2025. https://integratehealth.org/fr/sante-integree-forme-des-guerisseurs-traditionnels-dans-le-district-de-la-binah/.
5 Nigeria lance une initiative de phytomédecine pour stimuler l’économie et la santé. XinhuaNet, 8 mai 2025, consulté en mai 2025. https://french.news.cn/20250508/c9d6b2d94a6842f8a7b03c2e34e8d597/c.html.