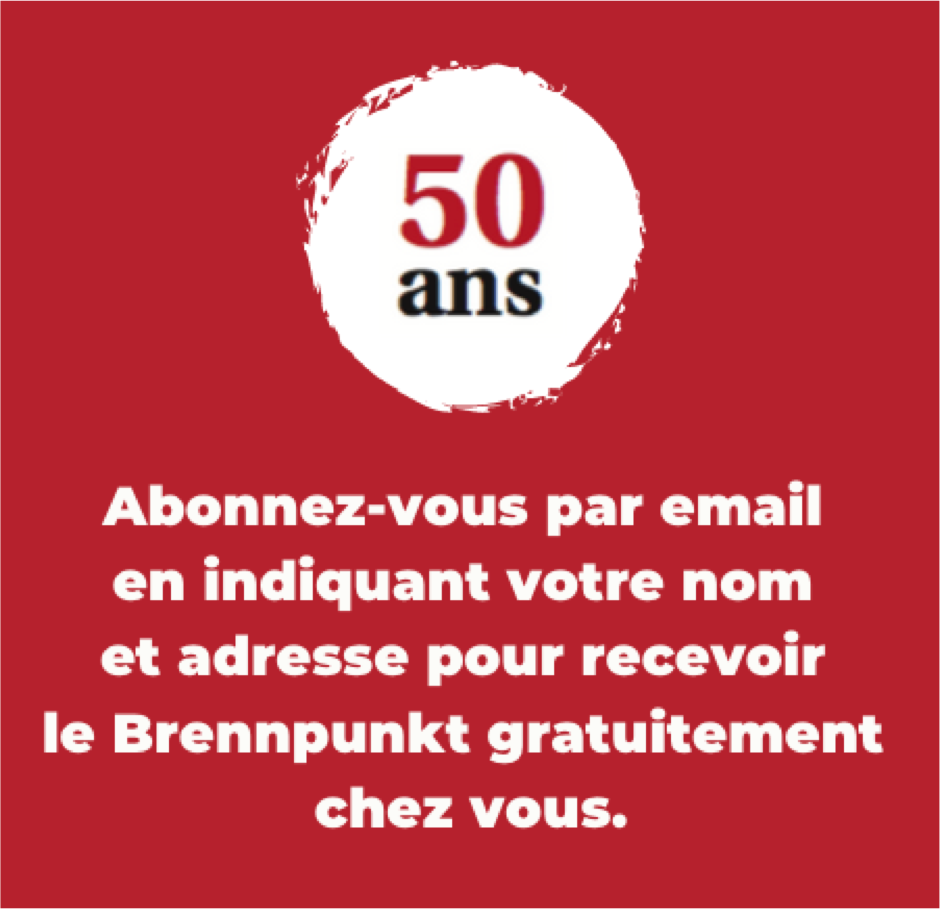Penseur majeur de la décolonisation, Martiniquais, Frantz Fanon(1925-1961) a développé une critique radicale du colonialisme, mais aussi des institutions internationales censées garantir la paix et les droits de l’homme, comme l’ONU. Mais peut-on dire qu’il est aussi anti-ONU ? Fondée en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’ONU s’est donnée pour mission de maintenir la paix, de promouvoir les droits de l’homme et de garantir l’égalité souveraine des peuples. Noble vocation sans contredit. Mais à l’époque des luttes de libération anticoloniale, vocation problématique. « L’ONU n’a jamais été capable de régler valablement un seul des problèmes posés à la conscience de l’homme par le colonialisme, et chaque fois qu’elle est intervenue, c’était pour venir concrètement au secours de la puissance colonialiste du pays oppresseur. » Les griefs soulevés par Fanon contre l’ONU font-ils de lui un adversaire de cette organisation ?
Les vécus du colonisé et du colon selon Fanon
Une équation : colonisation égale violence totale, car mortelle, annihilatrice d’êtres, pour le colon comme pour le colonisé. Pour le colonisé, colonisation, violence, pas seulement politique ou économique. Elle est ontologique, touchant à la quintessence de son être : il n’est nullement un humain, il est par exemple, Noir, et donc sous-humain. L’esclavagiste se référerait au Code Noir et dirait de lui « un bien meuble ». Dépossédé de sa terre – un bien meuble peut-il être propriétaire ? En son essence, colonisation est aussi dépossession. Pire, le colonisé est dépossédé de son corps, de sa langue, de sa culture et n’a pas d’histoire. « L’Africain n’est pas encore entré dans l’histoire », dit-on. Son univers est déstructuré : sans contre-violence, irrémédiable dépendance, infériorisation figée dans le marbre de l’essentialité, peur psychotique, honte de soi conative, éternel obséquieux silence ! Le colonisé est nié. Les conséquences sont devinées : intériorisation de la violence, suicides ou psychiatrie. S’ensuivent alors la kyrielle des traitements abêtissants. Ces caractéristiques affligeantes déterminent et expliquent l’orientation du psychiatre et homme politique, Fanon.
Le désastreux « diagnostic de situation » devrait nous dissuader de la nécessité de décrire le colon. Il est « raciste dans une culture avec racisme » car « tout groupe colonialiste est raciste ». C’est celui qui, « à longueur de journée », peut à merveille « frapper le colonisé, l’insulter, le faire mettre à genoux ». Le colon est l’acteur de la mise au tombeau de l’humanité du colonisé. Catalyseur permanent du misérable et affolant vécu du colonisé : « Les dangers qui […] menacent » ce dernier dans son être entier sont œuvre du colon et de son système. Mais, Fanon ne croit pas le colon exempt de toute souffrance. Le colon vit les affres de la colonisation. Premier à souffrir des conséquences du projet d’aliénation psychologique, de déshumanisation et de décérébralisation de l’autre entrepris par son groupe. Refusant toute remise en question du système létal qu’il sert, il meurt intellectuellement, moralement, politiquement. Il dépend entièrement d’un système qui le déshumanise.
Fanon et les Nations-Unies
Spectateur écrasé, le psychiatre Fanon a été saisi par le devoir de « décolonisation ». L’impératif de la décolonisation a fait de Frantz Fanon l’un des pionniers d’un universel humanisme du combat légitime, qu’il soit armé ou non.
Parlant de contre-violence, de légitime violence, Fanon aurait pu s’en tenir à l’article 51 des Nations-Unies stipulant cette « règle primaire » de « l’ordonnancement juridique international ». Non, il dénonce plutôt l’ONU, dominée par les puissances européennes dont elle se fait complice.
L’ONU, les pays occidentaux, capitalistes et leurs aliénés suppôts se posent en architectes de la déshumanisation des peuples en quête d’émancipation. C’est ce que Fanon lui reproche. L’expertise polyvalente et l’intense engagement politique de Fanon lui rendaient impossible de se taire devant un ordre international incapable d’arrêter la colonisation barbare par la France contre l’Algérie et d’autres pays colonisés.
L’impératif du combat anticolonialiste : de la psychiatrie à l’éthique politique
La vie du colonisé « ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon ». La violence s’impose. Plus précisément, la contre-violence, pour la dignité et non par haine du colon. Pas de ressentiment, de racisme, pas même le naturel « désir légitime de vengeance ». En asile psychiatrique, les patients sont traités pire que des sous-hommes, des non-humains.
L’équivalent rationnel du concept d’état de nature (philosophie politique classique), s’expérimente sur le terrain même de la colonisation. Il est ici à penser comme état de guerre, car état d’assujettissement, de décérébralisation, d’anéantissement de l’humain. Tenons la contre-violence de Fanon pour le concept de préservation de soi. Il s’agit davantage de reconstruction de l’homme dans sa dignité, problème d’ordre existentiel, que d’une simple légitimation de l’ordre politique national et international.
Fanon ne fait nullement l’apologie de la violence. Il s’agit plutôt d’enseigner la nécessité de la libération et de l’émancipation inéluctables des peuples.
Cette violence contre le système colonial, Fanon l’appelle « racisme antiraciste », cette « volonté de défendre sa peau », une réponse du colonisé à l’oppression coloniale. Cette réponse représente le fondement, « des raisons suffisantes pour s’engager » dans une « lutte anti-coloniale ». Nul besoin « de déclarations très belles dans la forme mais totalement vides de contenu, maniant dans une complète irresponsabilité des phrases qui sortent en droite ligne des traités de morale ou de philosophie politique » occidentaux. Pas d’ « idées démocratiques à prétention universalisante », de « catéchisme humaniste minimum », alors même que l’on déshumanise l’humanité par les tortures et les massacres : c’est ce contre quoi s’insurge notre psychiatre et homme politique de terrain.
Proposition d’un humanisme radical
Sur le plan philosophico-politique, non seulement son principe d’action décolonisatrice, la violence, rejoint celui, universel, de la préservation de soi, mais Fanon n’a de cesse de clamer le principe fondationnel de l’humanité : la dignité humaine comme l’archè des archès régissant les relations tant interpersonnelles qu’internationales. Philosophie politique de la violence ? Freud s’accorderait avec Frantz Fanon pour dire que « l’instinct de conservation […] de nature érotique – “exactement au sens d’Eros dans le Banquet de Platon” – ; mais c’est précisément ce même instinct qui doit pouvoir recourir à l’agression, s’il veut faire triompher ses intentions. » La violence coloniale « ne s’arrête que devant une autre violence ».
Rejet de l’ordre international et son modèle occidental d’émancipation fondé sur l’exclusion des couches sociales inférieures, imposé d’en haut. L’ONU n’est qu’un simple rouage du capitalisme mondialisé, dont les instruments économiques sont l’aide, la dette, le FMI, la Banque mondiale, etc. La voix des colonisés y est marginalisée, les peuples en lutte réelle durement traités car considérés comme terroristes, barbares. Pour autant, ces idées tranchées, anti-onusiennes et anti-impérialistes, ne font nullement de Fanon un anti-internationaliste. Que les peuples opprimés (Afrique, Asie, Amérique latine) s’organisent et combattent vaillamment le racisme et la violence institutionnelle de la colonisation. Fanon défend donc un universel construit depuis la base, depuis l’histoire des opprimés, et il propose un humanisme radical, un monde où chaque peuple compte, non pas selon des critères de puissance, mais d’égale dignité. Que règne le principe d’humanité dans l’égale dignité ! Tel est son message.
Bibliographie
Fanon, F., Les damnés de la terre, La Découverte, Paris, 2002.
Fanon, F., Peau noire, masques blancs, Collection : La condition humaine, Les Éditions du Seuil, Paris, 1952, 239 pp. (Une édition électronique réalisée à partir du texte de Frantz Fanon réalisée par une doctorante en sociologie à l’Université de Montréal).
Fanon, F., Pour la révolution africaine, Ecritspolitiques, La Découverte Poche, Paris, 2006.
Albert, E, Freud, S., Pourquoi la guerre ?, Préface de Christophe David, Payot et Rivages, Paris, 2005.