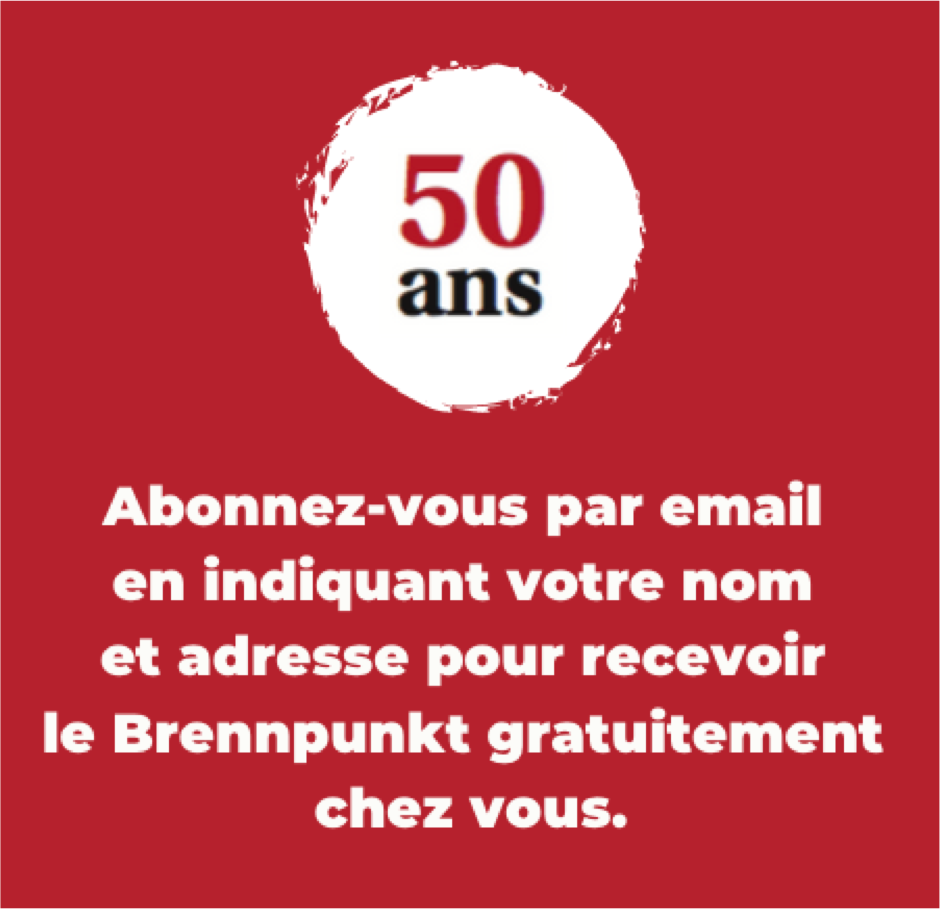MSF ne reçoit pas de financements gouvernementaux mais le désengagement des bailleurs de fonds au niveau mondial implique des conséquences mortelles dont nos équipes sont déjà témoins.
Tandis que nous écrivons ces lignes, plus de 100 jours se sont écoulés depuis que l’administration Trump a suspendu toute aide internationale en attendant une révision. Depuis, la plupart des financements américains pour les programmes de santé mondiale et d’aide humanitaire ont été supprimés, les organes de supervision démantelés, et le personnel clé remercié. Cette interruption massive a des conséquences catastrophiques pour des millions de personnes qui dépendent de cette aide pour survivre, mais elle révèle aussi une tendance bien plus large et profondément inquiétante : le recul global du financement structurel au profit d’interventions d’urgence à court terme.
Selon Avril Benoît, Directrice exécutive de Médecins Sans Frontières USA, les coupes budgétaires décidées par l’administration Trump constituent une catastrophe d’origine humaine pour des millions de personnes déjà confrontées à des situations d’extrême urgence, telles que les conflits armés, les épidémies ou les crises humanitaires. Bien que MSF soit habituée à intervenir dans des contextes critiques, l’organisation n’a jamais été témoin d’un tel niveau de perturbation dans les programmes de santé mondiale et d’aide humanitaire. À ses yeux, les conséquences sont potentiellement dramatiques, notamment parce que les bénéficiaires de cette aide figurent parmi les plus vulnérables au monde.
En tant qu’organisation médicale humanitaire présente dans plus de 70 pays, MSF fournit des soins de santé dans des contextes de conflit, de déplacement, d’épidémie et d’effondrement des systèmes — souvent là où peu d’autres acteurs sont présents. Financée de manière indépendante et ne recevant aucune aide gouvernementale, MSF peut s’exprimer librement sur les lacunes critiques constatées sur le terrain.
Dans de nombreux contextes, nos équipes constatent déjà les effets du retrait des bailleurs : ruptures de stocks de traitements antirétroviraux, antipaludiques et antituberculeux, patients parcourant de longues distances pour être refoulés, agents de santé communautaires non rémunérés ou insuffisamment soutenus, et activités de prévention essentielles non financées. Ces défis ne se limitent pas aux contextes dits « fragiles » : ils existent aussi dans des pays aux systèmes de santé fonctionnels mais sous-financés.
Un désengagement global, et pas seulement américain
Les États-Unis ont longtemps été le principal contributeur mondial aux programmes de santé et d’aide humanitaire, représentant environ 40 % de tous les financements. Ces investissements ont permis de sauver des vies grâce à des soins médicaux, des campagnes de vaccination, l’accès à l’eau potable, et le renforcement des systèmes de santé dans des contextes fragiles à travers le monde. Ils représentaient également moins de 1 % du budget fédéral américain.
Mais ce retrait abrupt et dramatique n’est pas un phénomène exclusivement américain. À travers le monde, on observe une inquiétante érosion des engagements des bailleurs envers les programmes de santé structurels et de long terme. En Europe et ailleurs, les budgets d’aide sont en baisse et les priorités en matière de santé mondiale sont redéfinies selon des logiques politiques et économiques qui négligent les besoins des communautés vulnérables.
Ainsi, l’Allemagne – deuxième donateur mondial derrière les États-Unis – a réduit de 53% son budget consacré à l’aide humanitaire.¹ En France, ce budget a subi une baisse de 37%², tandis que la Belgique a décidé de réduire son financement de l’aide au développement de 25% sur cinq ans³. Si certains pays, comme le Luxembourg, font exception en maintenant à priori leur budget à 1 % du RNB pour la coopération, la réduction des aides reste une dynamique malheureusement contagieuse.
L’aide structurelle disparaît, mais les besoins, eux, ne disparaissent pas ; ils s’aggravent, jusqu’à devenir des urgences.
L’urgence devient le mode par défaut
Nous sommes une organisation médicale d’urgence. Intervenir lorsque des vies sont en danger fait partie de notre mission. Mais nous n’avons jamais été témoins d’une perturbation de cette ampleur dans les opérations de santé mondiale et d’aide humanitaire.

Dans des pays comme le Yémen et l’Afghanistan, la décision de l’administration américaine d’annuler presque toute l’aide humanitaire a mis des millions de personnes en danger. Rien qu’au Yémen, 19,5 millions de personnes — soit plus de la moitié de la population — dépendent de l’aide. Mais les effets de ces coupes vont bien au-delà de ces deux pays. Des organisations financées par les États-Unis ont été contraintes d’annuler ou de réduire des programmes cruciaux à travers le monde : campagnes de vaccination, services de santé reproductive, soutien aux populations touchées par les conflits, projets d’eau et d’assainissement, et soins aux personnes déplacées.
Avril Benoît dénonce la décision des États-Unis de renoncer à leur rôle de leader dans les efforts de santé mondiale et d’aide humanitaire. Elle estime que l’aide américaine constitue une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, et que sa suppression risque d’entraîner une hausse des décès évitables ainsi que des souffrances considérables à travers le monde.
Ce basculement du financement structurel vers l’aide d’urgence réactive crée une norme dangereuse. Sans soutien constant, les interventions précoces disparaissent. Les systèmes de santé fragiles s’effondrent. Les services de base se dégradent — jusqu’à ne plus pouvoir répondre aux besoins courants des populations. Ce qui était évitable devient alors urgent, mortel, et beaucoup plus coûteux à gérer.
Aucune organisation ne peut y faire face seule
MSF ne reçoit pas de financement du gouvernement américain. Nous restons engagés à fournir des soins partout à travers le monde. Mais la disparition d’autres acteurs et l’effondrement des mécanismes de coordination ont déjà un impact sur notre travail. Les ministères de la Santé disposent de moins de ressources, les partenaires communautaires disparaissent, et les systèmes d’orientation des patients se désagrègent. Les effets en cascade nous touchent tous.
Lorsque l’aide structurelle est supprimée, les acteurs humanitaires doivent accomplir l’impossible : faire plus avec moins, répondre non seulement aux crises aiguës, mais aussi aux besoins chroniques et systémiques, désormais privés de soutien durable.
Nous en constatons déjà les conséquences tragiques : des vies perdues non pas parce que les soins étaient impossibles, mais parce que les systèmes censés les fournir ont été démantelés.
Nous devons rejeter cette nouvelle norme dangereuse
Nous ne pouvons pas accepter un monde où la seule réponse aux besoins de santé est l’intervention d’urgence, c’est-à-dire lorsqu’il est souvent déjà trop tard. Nous appelons tous les donateurs, et pas seulement les États-Unis, à réaffirmer leurs engagements en faveur d’une aide humanitaire et de santé à long terme, fondée sur les besoins. L’investissement durable n’est pas de la charité. Il est la base même de la stabilité mondiale, de l’équité et de la survie.
Car quand l’aide structurelle disparaît, les urgences ne s’évaporent pas — elles se multiplient.
De la gestion de crise à l’engagement durable : un test pour la solidarité mondiale
Le retrait croissant du financement structurel et de long terme n’est pas seulement un changement politique — c’est un pari qui met des vies en danger. Il menace l’existence même de programmes essentiels, notamment dans les pays où les systèmes de santé publique dépendent fortement d’un soutien international continu. À l’approche d’échéances financières majeures, comme la huitième reconstitution du Fonds mondial pour 2026–2028, l’enjeu n’a jamais été aussi crucial. Ce moment servira de test décisif : les gouvernements et donateurs continueront-ils à investir dans la prévention, la continuité des soins et la résilience des systèmes de santé — ou se contenteront-ils de réagir à la prochaine urgence inévitable ?
¹) En 2023, le gouvernement fédéral a alloué 2,7 milliards d’euros à l’aide humanitaire, ce qui représente une réduction significative par rapport aux années précédentes. Source: Aide humanitaire, Tatsachen über Deutschland, https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fr/paix-et-securite/aide-humanitaire, consulté le 16 juin 2025.
²) La stratégie humanitaire de la France pour 2023-2027 mentionne une réduction des fonds alloués à l’aide humanitaire, avec un objectif de 1 milliard d’euros par an d’ici 2025. Source: Stratégie humanitaire de la République française 2023-2027, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-humanitaire-online_cle86fd8e-1.pdf, consulté le 16 juin 2025.
³) En Belgique, les priorités pour l’aide humanitaire sont définies par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Source: Nos priorités pour l’aide humanitaire, Service public fédéral Affaires étrangères – Belgique, https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation-au-developpement-et-aide-humanitaire/nos-priorites-pour-laide-humanitaire, consulté le 16 juin 2025.