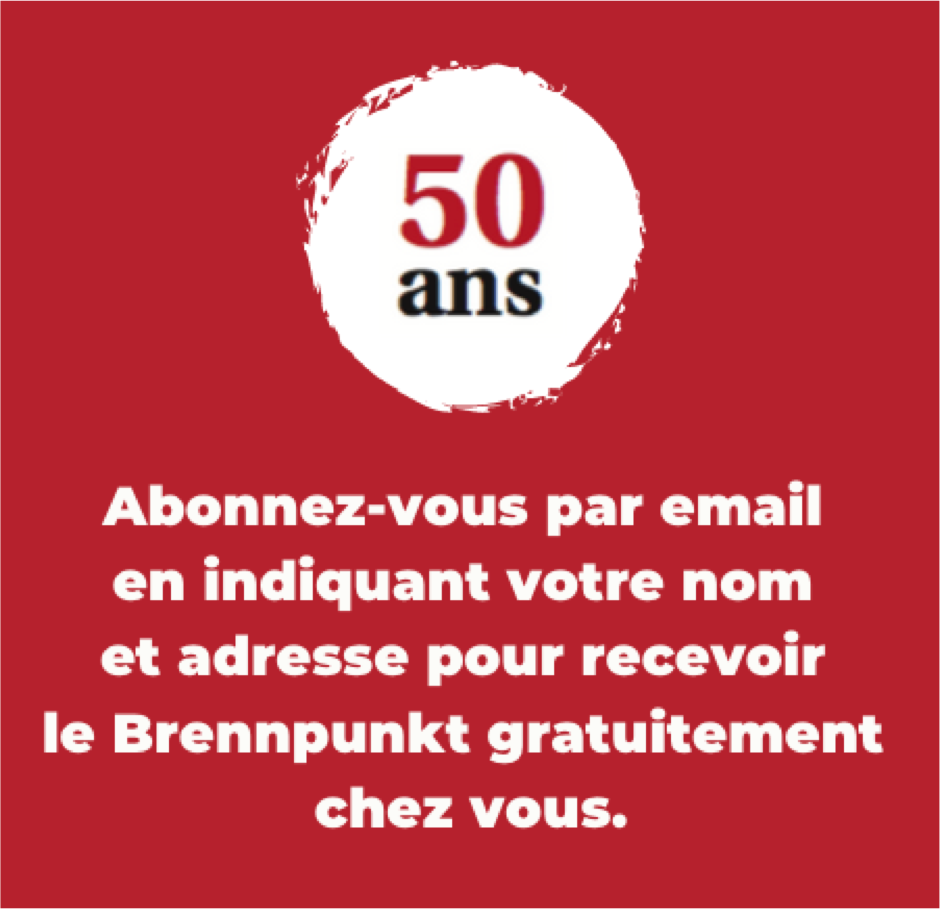https://www.brennpunkt.lu/es/bolivia-200-anos-de-lucha/ La Bolivie célèbre ce 6 août ses 200 ans d’existence en tant que pays indépendant. Indépendante de la colonie espagnole, certes, mais toujours soumise aux logiques extractivistes qui aggravent les conditions d’inégalité et de pauvreté, tout en provoquant des impacts socio-environnementaux définitifs pour sa population. Dans ce bref article, nous retraçons et rappelons ce cycle de dépendance et d’extractivisme qu’a connu la Bolivie, mais aussi les luttes sociales que son peuple a menées pour obtenir son indépendance, sa souveraineté et une vie meilleure.
200 ans d’extractivisme
La Bolivie attire actuellement l’attention internationale, car elle possède les plus grandes réserves mondiales de lithium, avec 23 millions de tonnes identifiées. Ce minerai essentiel à la fabrication des batteries au lithium est ainsi considéré clé de la transition énergétique et perçu comme solution face au changement climatique. Mais au même titre que d’autres minerais liés aux usages technologiques ou militaires, le lithium fait lui aussi partie de ces minéraux « critiques » dont l’approvisionnement a été identifié comme stratégique par les grandes puissances. Il est d’ailleurs certain qu’il jouera un rôle central dans les rivalités géopolitiques – rivalités qui se sont particulièrement intensifiées cette année.
Ceci inquiète la société civile bolivienne, car le gouvernement bolivien a déjà signé des contrats avec un consortium chinois (qui comprend CATL, leader mondial dans la fabrication de batteries) et une entreprise russe (filiale de l’entreprise publique Rosatom), ainsi que des accords avec des entreprises britanniques, franco-australo-allemandes, françaises, chinoises et argentines pour l’extraction de lithium dans sept salars 1. Ces deux contrats mentionnés sont, pour le moment, en attente de ratification par l’Assemblée législative, en raison de protestations des communautés locales indigènes et paysannes, ainsi que d’une partie de la société civile à l’échelle nationale. Ces contestations ont trait aux conditions économiques, sociales et environnementales défavorables pour le pays. Mais, au fond, ces inquiétudes sont aussi ancrées dans l’histoire de la Bolivie.
La Bolivie a joué un rôle clé dans l’histoire de l’Europe et du monde occidental. Elle abrite le Cerro Rico de Potosí, une mine qui fut le pilier de l’économie espagnole à l’époque coloniale et d’une grande partie de la richesse européenne de cette période. La ville de Potosí, située au pied de la montagne, fut, à un moment donné, l’une des villes les plus riches du monde, comparable à Londres à l’époque. Deux siècles se sont écoulés, mais cette histoire d’extractivisme perdure, au service finalement de la croissance des grandes puissances économiques, perpétuant un échange inégal et une dépendance persistante.
Alors même que la Bolivie devient indépendante, elle se voit contrainte de poursuivre une extraction d’argent datant de l’époque coloniale. L’extraction passe alors entre les mains d’oligarchies locales associées à des entreprises anglaises, reproduisant ainsi la même logique d’enrichissement d’une minorité et d’exploitation de la population locale, laissant derrière soi peu de ressources, des impacts environnementaux, des inégalités et de la pauvreté. Après l’ère de l’argent, vint l’époque de l’étain, menée ici aussi par des entrepreneurs nationaux soutenus par des capitaux britanniques. Ensuite vinrent le caoutchouc, le guano, le salpêtre et le pétrole, cette fois associés à des intérêts de grandes compagnies nord-américaines. Aujourd’hui, la Bolivie sort d’un autre pic de croissance économique grâce à l’exportation de gaz naturel ; mais à mesure que ces ressources s’épuisent, la baisse des recettes d’exportation est devenue un facteur central dans l’actuelle détérioration économique. Tous ces modèles extractivistes ont provoqué des périodes brèves de croissance basées sur l’exportation de matières premières, mais les conditions imposées par les grandes puissances (qui ont su imposer leurs entreprises d’extraction en s’alliant avec les oligarchies, entrepreneurs et gouvernements locaux) ont finalement conduit à une fuite des richesses et profits à l’étranger, laissant derrière elles des dettes environnementales, des économies locales fragilisées, des sociétés désarticulées et des pratiques culturelles et institutionnelles délétères.
En 2025, la Bolivie est confrontée à l’aggravation d’une crise économique très profonde et complexe. Résultat direct d’un modèle économique extractiviste qui, malgré son visage communautaire et social vanté par la propagande, n’a que désindustrialisé l’économie, renforcé la dépendance aux exportations de matières premières (soja, minerais, hydrocarbures), dérégulé les normes et institutions de contrôle environnemental, social, fiscal et du travail, et instauré des pratiques de répression et de criminalisation des voix critiques, tout en démantelant les organisations sociales par la cooptation, la corruption et les pratiques clientélistes.
À la veille des nouvelles élections nationales — par coïncidence également prévues en août — tous les candidats de tous les partis politiques promettent, une fois de plus, que l’extraction et la vente du lithium sortiront le pays de la crise. Une promesse désormais stimulée non seulement par la demande mondiale liée à la transition énergétique, mais aussi par les offres, promesses et pressions des grandes puissances (Chine, Russie, Europe), qui ont accéléré et intensifié leurs stratégies pour sécuriser ces minerais critiques face aux incertitudes engendrées par un contexte international imprévisible.
Cinq cents ans d’extractivisme comme colonie espagnole, et deux cents ans comme pays indépendant. À l’aube d’un nouveau siècle, la société civile bolivienne espère que le lithium, les tensions géopolitiques actuelles et les transformations en cours dans le monde ne serviront pas à reproduire ce même cycle extractiviste.
200 ans de luttes sociales
Ce panorama économique est sans doute décourageant. Mais ce qui a aussi caractérisé la Bolivie tout au long de son histoire, coloniale et postcoloniale, ce sont les luttes et les rébellions sociales pour changer ces conditions inéquitables.
Bien que la Bolivie ait été l’un des derniers pays à obtenir son indépendance de la couronne espagnole, elle fut la première à se rebeller. Inspirée par les mouvements d’indépendance des États-Unis et mue par la volonté de défendre les principes de liberté, d’égalité et de fraternité de la Révolution française, c’est en Bolivie que démarra en 1809 la rébellion sud-américaine qui allait ensuite se propager à tout le continent. Durant sa vie républicaine, elle fut également le théâtre de nombreuses rébellions indigènes contre les oligarchies locales. Des luttes nationalistes contre le pouvoir en place et le contrôle des sociétés minières ont conduit à une série de révolutions qui ont permis des transformations révolutionnaires, faisant de ce pays l’un des pionniers du continent en matière de réformes concernant la distribution des terres, le suffrage universel et l’éducation comme droit. Les luttes menées par des secteurs sociaux pauvres, ainsi que les mobilisations indigènes et paysannes contre les politiques néolibérales, ont abouti à des événements aussi marquants qu’internationalement connus, comme la Guerre de l’eau. Des luttes sociales qui ont permis des transformations constitutionnelles reconnaissant non seulement la diversité culturelle, mais aussi l’existence de plusieurs nations indigènes et originaires faisant partie intégrante de ce même pays.
Ces luttes ont toujours été complexes à comprendre ou à anticiper, mais elles ont été puissantes, non seulement de par leur force de transformation, mais aussi de par leurs propositions. Ce sont justement ces crises économiques récurrentes qui ravivent la mémoire historique de rébellion et de mobilisation.
Nous espérons que cette histoire des luttes réémerge en ces moments difficiles que traverse actuellement la Bolivie, mais aussi qu’elle puisse inspirer des transformations sociales nécessaires à l’échelle internationale. Face à l’affaiblissement actuel des institutions multilatérales, à la remise en question des valeurs progressistes telles que les droits humains et la démocratie, ainsi qu’à l’impunité des élites et dirigeants mondiaux, nous devons tous nous rappeler de nos luttes pour la justice, la liberté, l’équité et l’avenir pour la planète entière.
Note
1 Un salar est un désert de sel, aussi appelé plaine saline ou lac salé, qui est un bassin fermé où l’eau s’évapore, laissant derrière elle une couche de sels et minéraux. Ces bassins peuvent être temporaires ou permanents, et leur superficie peut varier en fonction des saisons et des précipitations. Les salars sont souvent situés dans des régions arides ou semi-arides, où les précipitations sont faibles et l’évaporation est élevée.