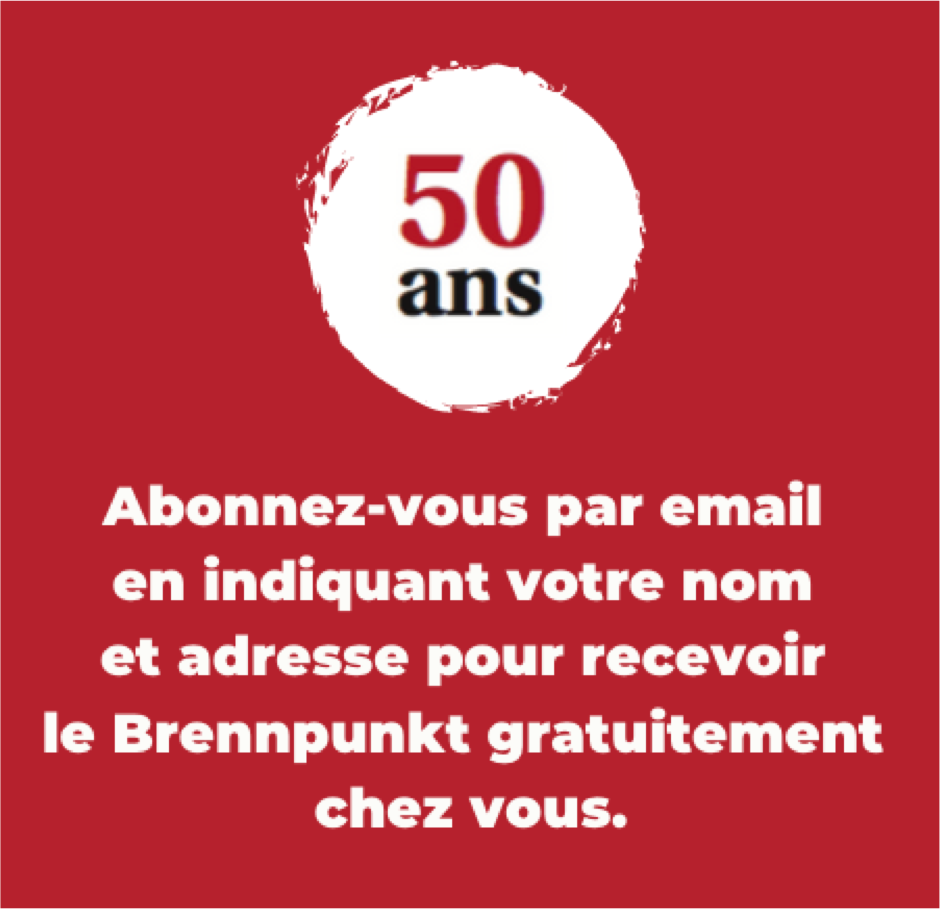Les droits liés au genre sont menacés dans le Nord global, et leur érosion a des répercussions dans le monde entier. Ces reculs sont le signe de crises plus profondes : néo-populisme, tensions économiques et montée de l’antimultilatéralisme. Lorsque les droits liés au genre sont remis en cause, d’autres droits sont souvent menacés à leur tour.
Le terme « polycrise » s’est rapidement imposé dans les débats politiques et universitaires pour désigner l’enchevêtrement des crises mondiales qui se superposent. Il a été utilisé la première fois dans un contexte européen par Jean-Claude Juncker en 2016 pour évoquer les défis liés à la migration, à l’économie et à la sécurité auxquels l’Union européenne était alors confrontée(1). L’historien Adam Tooze a ensuite popularisé ce concept pour décrire les crises qui se renforcent mutuellement au début des années 2020, du changement climatique aux pandémies, en passant par la guerre et l’instabilité financière(2). Contrairement aux expressions « crises multiples » ou au raccourci journalistique « permacrise », qui suggèrent une succession sans fin de chocs, le concept de polycrise met l’accent sur l’interdépendance. Les crises s’alimentent mutuellement, produisant des effets en cascade souvent imprévisibles, qui ne peuvent être traités séparément.
Reconnaître que la situation mondiale actuelle est une polycrise, c’est admettre qu’elle est structurelle et systémique. Les solutions qui ne s’attaquent qu’à un seul problème sont vouées à l’échec si elles ignorent les effets domino de cette dynamique. Les catastrophes climatiques perturbent les systèmes alimentaires, provoquant ainsi des migrations et de l’instabilité politique. Les chocs économiques renforcent la polarisation, alimentant ainsi les mouvements anti-droits. La guerre et la militarisation réduisent l’espace civique et renforcent l’autoritarisme, marginalisant encore davantage les personnes les plus exposées aux chocs climatiques et économiques.
Le genre est au cœur de ces crises qui s’entremêlent. Les reculs que l’on observe, qu’il s’agisse de l’égalité entre les genres, de la protection des personnes LGBTQ+, des droits des personnes en situation de handicap ou encore de la justice raciale, ne sont pas des revirements politiques isolés, mais font partie d’un modèle plus large de la polycrise. Ils sont à la fois des symptômes et des accélérateurs. Les crises offrent un terreau fertile aux mouvements anti-genre et à la recherche de boucs émissaires, tandis que les reculs en matière de droits affaiblissent la capacité des sociétés à faire face aux chocs futurs. Loin d’être secondaire par rapport aux crises « fondamentales » du climat, de l’économie ou de la sécurité, le genre est un test décisif de la manière dont les sociétés gèrent, ou non, le stress systémique et la violence structurelle.
Pourtant, ni la gouvernance nationale ni la gouvernance multilatérale ne semblent prêtes à réagir. Dans de nombreuses démocraties occidentales, les choix politiques privilégient le démantèlement des acquis passés et la défense des intérêts des plus riches, des industries de l’armement et des énergies fossiles. Les pays donateurs du Nord démantèlent les protections qu’ils avaient autrefois encouragées, tandis que les organisations multilatérales cèdent sous la pression politique et financière. Il est donc essentiel de comprendre les dimensions sexospécifiques de la polycrise et la manière dont elles interagissent avec la définition des priorités et le financement à l’échelle mondiale afin de développer des approches résilientes en matière de protection des droits. La polycrise ne renforce pas seulement les vulnérabilités liées au genre, elle accélère aussi le recul du multilatéralisme en matière de droits liés au genre et aux questions intersectionnelles, poussé par les choix politiques des pays donateurs.
Le Nord global, moteur de la polycrise genrée
Les pays qui étaient autrefois considérés comme des champions de l’égalité des sexes ont commencé à supprimer les protections qu’ils avaient mises en place. Ces revirements sont importants non seulement en raison de leur impact au niveau national, mais aussi parce que ces mêmes pays continuent d’exercer une grande influence sur la définition de l’agenda mondial des institutions multilatérales et de la coopération au développement. Lorsque les gouvernements du Nord global restreignent les droits au niveau national, les conséquences se font sentir bien au-delà de leurs frontières, influençant la réponse internationale à la polycrise tout en la sapant.
Au Royaume-Uni, la politique anti-genre s’est vraiment affirmée en 2025, à la suite de plusieurs changements juridiques et politiques qui ont sérieusement remis en cause les droits des personnes transgenres et de genre divers. Le 16 avril, la Cour suprême a décidé, dans l’affaire For Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers, que les termes « homme », « femme » et « sexe » de la loi sur l’égalité de 2010 devaient être interprétés comme renvoyant uniquement au sexe biologique, y compris pour les personnes ayant un certificat de reconnaissance de genre.(3) Human Rights Watch a critiqué cette décision, la qualifiant de recul pour les droits des personnes transgenres et soulignant qu’elle les empêchait de fait d’accéder à des espaces non mixtes correspondant à leur identité.(4) Les conséquences ont été immédiates : les organismes publics ont reçu pour instruction de revoir leurs politiques d’accès aux espaces et services réservés à un genre particulier, renforçant ainsi l’exclusion dans les refuges, les installations sportives et les établissements de santé. La Commission pour l’égalité et les droits humains (The Equality and Human Rights Commission) a suivi avec des directives provisoires demandant aux organismes publics de considérer les femmes transgenres comme des « hommes biologiques » dans les écoles, sur les lieux de travail, dans les hôpitaux et les services.(5) En même temps, l’accès aux soins de santé a été restreint : en mars 2024, le service national de santé (NHS) a interdit de manière permanente la prescription de bloqueurs de puberté aux adolescents, à la suite du rapport final de l’examen Cass (Cass Review).(6) Les critiques estiment que ces mesures constituent une forme d’hostilité institutionnalisée à l’égard des personnes de genre divers et font reculer des décennies de progrès.
Ces mesures montrent à quel point les droits peuvent être rapidement démantelés, même dans les démocraties où les droits humains sont solidement ancrés. En privilégiant une vision biologique essentialiste du genre, la décision du Royaume-Uni favorise l’exclusion institutionnelle et la polarisation de l’identité de genre en tant que ligne de fracture politique plutôt que comme une question de droits ou de bien-être. Les obstacles aux soins affirmant le genre, l’exclusion systémique dans le domaine de la santé et le poids émotionnel de la discrimination politique se traduisent déjà par une nette détérioration de la santé au sein de cette communauté.(7)
Aux États-Unis, le recul a été encore plus radical. En 2025, le « One Big Beautiful Bill » de l’administration Trump a bloqué le financement du planning familial (Planned Parenthood) par Medicaid pendant un an, mettant en péril près de 200 cliniques et plus d’un million de patients à faibles revenus.(8) Le financement du Titre X a également été gelé, privant les prestataires de soins de santé reproductive de 65,8 millions de dollars et laissant sept États sans couverture.(9) Les autorités ont aussi détruit pour 9,7 millions de dollars de contraceptifs destinés à cinq pays africains, ce qui devrait entraîner 174 000 grossesses non désirées et 56 000 avortements dangereux.(10)

(c) La Maison Blanche, via Wikimedia Commons (domaine public)
Outre les droits reproductifs, les protections pour les personnes LGBTQ+ ont été sérieusement visées. Entre mai et août 2025, le gouvernement a notamment remis en place l’interdiction pour les personnes transgenres de servir dans l’armée, supprimé 800 millions de dollars de financement fédéral pour la recherche sur les questions LGBTQ+, même lorsque celle-ci portait sur des problèmes de santé publique plus larges, censuré la collecte de données nationales sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et imposé de nouvelles restrictions sur les soins affirmant le genre aux niveaux fédéral et des États.(11) Les écoles ont renforcé les lois Don’t Say Gay(12), interdisant les discussions en classe sur l’identité de genre, tandis que les bibliothèques ont été menacées de perdre leur financement pour avoir hébergé des documents inclusifs LGBTQ+.(13) Ces mesures ont renforcé un climat d’effacement et de silence, présentant l’identité de genre et l’expression sexuelle non pas comme des droits, mais comme des responsabilités politiques.
Ces actions montrent comment les crises de gouvernance, les tensions économiques et la polarisation politique créent un terreau propice aux mouvements anti-genre. Aux États-Unis, le recul des droits reproductifs et LGBTQ+ ne constitue pas une guerre culturelle isolée, mais s’inscrit dans une dynamique de polycrise plus large, où les divisions sociales sont exploitées pour détourner l’attention des échecs en matière d’action climatique, de résilience économique et de stabilité démocratique. Des chercheurs ont montré que les restrictions en matière de reproduction coûtent chaque année des centaines de milliards de dollars à l’économie américaine, avec 68 milliards de dollars de pertes de revenus dans seulement 16 États après l’arrêt Roe, et 173 milliards de dollars par an à l’échelle nationale. Ces mesures causent donc un réel préjudice macroéconomique tout en servant de diversion idéologique.(14) En parallèle, l’administration Trump a supprimé toute référence à la diversité, à l’équité et à l’inclusion au sein des agences fédérales, y compris les termes « genre » et « femmes dans des postes de direction » à la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et à la Food and Drug Administration (FDA), et a systématiquement démantelé les soins affirmant le genre ainsi que les protections juridiques pour les personnes LGBTQ+ par le biais de décrets et de lois au niveau des États.(15) Ces suppressions politiquement motivées de l’identité et des droits se produisent dans un contexte où la réglementation climatique est en train d’être démantelée(16), où les sciences environnementales sont privées de financement(17), et où les filets de sécurité sociale sont érodés(18), ce qui fait de la réaction contre le genre à la fois une conséquence et un moteur de la polycrise.
L’Europe, souvent considérée comme un bastion de la protection sociale, n’est pas épargnée. Les féminicides restent très fréquents : le European Institute for Gender Equality (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes) estime qu’au moins 4 000 femmes sont tuées chaque année par leur partenaire ou un membre de leur famille, même si ce chiffre est probablement sous-évalué en raison des cas non signalés.(19) Les données d’Eurostat montrent qu’en Europe, les femmes sont tuées par des membres de leur famille ou leurs partenaires intimes à un rythme environ deux fois supérieur à celui des hommes, et que l’écart se creuse encore davantage lorsqu’on ne prend en compte que les partenaires intimes.(20)
De nouvelles formes de violence sexiste se multiplient dans les espaces à la pointe de la polycrise, là où les bouleversements technologiques et la désinformation se mêlent à la violence sexiste. Le rapport 2024 de l’Europol sur l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur Internet (« Internet Organised Crime Threat Assessment ») fait état d’une forte augmentation des cas de sextorsion et de partage d’images non consensuelles, qui touchent principalement des mineurs.(21) Le Conseil de l’Europe a également mis en garde contre la propagation rapide de la pornographie deepfake et du harcèlement en ligne, qui touchent surtout les jeunes femmes et les personnalités publiques.(22)
Ces reculs matériels sont renforcés par une réaction culturelle. En 2023, la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen a souligné la croissance rapide de communautés en ligne qui sont à la fois misogynes et liées aux mouvements d’extrême droite.(23) Le Centre for Countering Digital Hate a montré que les algorithmes de TikTok et de YouTube proposaient des contenus incels et misogynes aux adolescents quelques heures seulement après la création d’un compte, normalisant ainsi le harcèlement et alimentant la violence hors ligne.(24)
Ensemble, ces tendances montrent comment la polycrise que traverse l’Europe – marquée par l’incertitude économique, la montée de l’extrémisme et les bouleversements technologiques – a favorisé des politiques régressives en matière d’égalité des sexes. Les recherches montrent qu’en période de tensions financières et d’austérité, les questions féministes sont souvent mises de côté dans l’élaboration des politiques. Les chercheurs qui ont analysé les crises économiques passées en Europe ont notamment montré comment les questions de genre avaient été reléguées au second plan au profit de la stabilisation macroéconomique, renforçant ainsi l’invisibilité structurelle des besoins des femmes.(25) En affaiblissant les protections et en reléguant l’égalité des sexes au second plan, l’Europe ne se protège pas des crises plus générales ; elle sape sa propre stabilité. L’érosion de la justice de genre devient à la fois un symptôme de tensions aggravées et un accélérateur de la fragilité politique et de la désintégration sociale, sapant la résilience et la crédibilité de la région dans son ensemble.
Du recul national au recul mondial
Ces exemples montrent que le genre est au cœur de la polycrise que nous traversons. Les chocs économiques, la polarisation politique et les bouleversements technologiques se combinent pour éroder les droits liés au genre et aggraver l’instabilité générale. Et surtout, le Nord global n’est pas en reste dans cette dynamique ; il la mène. Comme ces États ont une influence disproportionnée sur les institutions multilatérales et les flux d’aide, leurs reculs nationaux ne s’arrêtent pas au niveau national. Ils se répercutent au-delà des frontières, influençant les priorités humanitaires et de développement, réduisant l’espace civique et redéfinissant les limites de ce qui est politiquement ou financièrement possible sur la scène mondiale. Les conséquences sont évidentes dans le recul de l’aide : les choix politiques du Nord aggravent directement les vulnérabilités du Sud et exacerbe les crises qu’ils prétendent combattre.
En juillet 2025, le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (Foreign, Commonwealth & Development Office) a annoncé que l’aide bilatérale destinée à l’Afrique, au Moyen-Orient, à l’égalité des sexes, à l’éducation et aux programmes de santé serait réduite en 2025/2026, avec une baisse de 6 % du budget global de l’aide publique au développement (APD).(26) Les dépenses de santé devraient notamment baisser de près de la moitié par rapport à l’année précédente, avec des coupes dans les programmes de santé des femmes et d’intervention d’urgence en République démocratique du Congo (RDC), au Mozambique, au Zimbabwe et en Éthiopie. Une initiative phare en faveur de l’éducation des filles en RDC devrait prendre fin prématurément, privant ainsi 170 000 enfants de l’accès à l’éducation dans la région du Kasaï, qui sort d’un conflit.(27) Même l’évaluation d’impact sur l’égalité réalisée par le gouvernement lui-même a averti que ces réductions augmenteraient le fardeau des maladies, le nombre de décès prématurés et les effets négatifs sur les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap.
Cette réduction des dépenses du Royaume-Uni n’est pas un cas isolé, mais s’inscrit dans un recul systémique chez les principaux donateurs. Selon l’OCDE, 2025 marquera la première fois en près de trois décennies que les quatre principaux fournisseurs d’aide — la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis — auront simultanément réduit leur APD pendant deux années consécutives. L’APD nette devrait baisser de 9 à 17 %, ce qui représente une perte pouvant atteindre 56 milliards de dollars par rapport aux niveaux de 2023.(28) Les pays les moins avancés devraient perdre jusqu’à un quart de leur aide bilatérale en une seule année, l’Afrique subsaharienne devant faire face à des baisses de 16 à 28 %. Le financement de la santé, déjà instable depuis le pic de la réponse à la pandémie de COVID-19, pourrait diminuer d’un tiers, pour revenir aux niveaux du milieu des années 2000. Les coupes dans les contributions multilatérales aggravent la crise : les onze donateurs qui ont annoncé des réductions représentent plus de 60 % du financement de l’OMS et 87 % du financement du Programme alimentaire mondial.
Les organisations de la société civile soulignent que ces coupes budgétaires détruisent les systèmes de protection de première ligne. L’ILGA World et ses six fédérations régionales ont prévenu que les gouvernements réduisaient délibérément le financement des actions en faveur des femmes, des personnes LGBTQ+ et des groupes marginalisés, entraînant ainsi la fermeture de centres de santé, de safe spaces et de programmes communautaires.(29) Une enquête mondiale menée par ONU Femmes auprès de 411 organisations de défense des droits des femmes dans 44 pays touchés par des crises a révélé que 90 % d’entre elles avaient déjà été touchées par des coupes budgétaires et que plus de la moitié d’entre elles prévoyaient de fermer dans les six mois à moins de recevoir de nouvelles ressources.(30) La plupart de ces réductions ont touché les services liés à la violence sexiste, à la santé reproductive et à l’aide à la subsistance, alors que plus de 500 femmes et filles meurent chaque jour dans des contextes fragiles de complications évitables liées à la grossesse et à l’accouchement.
Les données récentes sur le financement montrent également que le système d’aide humanitaire est fragile. Comme le souligne The New Humanitarian, les fonds humanitaires ont atteint un pic en 2022, mais ont stagné chez la plupart des donateurs de l’OCDE l’année suivante, la hausse du financement américain masquant le déclin général.(31) Lorsque l’administration Trump a démantelé l’USAID au début de l’année 2025, le secteur a perdu son plus grand stabilisateur presque du jour au lendemain, laissant les donateurs de taille moyenne et les petits donateurs dans l’incapacité de compenser. Le résultat est un système fragmenté dans lequel le financement est orienté vers des crises politiquement visibles, comme celles en Ukraine et en Palestine, tandis que les efforts à long terme en matière de développement et de consolidation de la paix dans les contextes fragiles sont relégués au second plan. Malgré des décennies de discours sur le « lien entre humanitaire, développement et paix », les tendances actuelles révèlent un cercle vicieux : les donateurs se replient sur l’aide humanitaire à court terme, réduisant ainsi le financement du développement et des droits, ce qui aggrave les crises, augmente la demande d’aide humanitaire et réduit la capacité des organisations de défense des droits à réagir.
Le coût mondial du retrait des donateurs
Ces actions mènent à un retrait de l’aide non pas comme une réduction, mais comme une escalade : un choix politique qui amplifie les pressions qu’il prétend alléger. Lorsque les gouvernements donateurs redirigent leurs ressources vers la défense ou des priorités nationales à court terme, les conséquences ne se limitent pas aux bilans financiers : les systèmes de santé déjà fragiles sont déstabilisés, les possibilités d’éducation sont réduites et les moyens de survie de ceux qui sont déjà les plus exposés à la crise sont coupés. Les femmes, les enfants, les personnes LGBTQ+, les migrants et les personnes en situation de handicap en paient le prix le plus fort, précisément parce que les organisations les mieux placées pour les soutenir, à savoir les acteurs féministes et les défenseurs des droits humains sur le terrain, sont privées de ressources. Il en résulte non seulement une diminution de la protection, mais aussi un affaiblissement de la capacité du système mondial à absorber les chocs et à renforcer la résilience. Dans ce contexte, le recul des pays du Nord par rapport à leurs propres engagements alimente activement la polycrise, exportant l’instabilité vers l’extérieur tout en affaiblissant les perspectives de solutions durables.
Le retrait des fonds des donateurs a laissé les organisations féministes et de la société civile dans une situation extrêmement précaire, alors que leur travail est plus important que jamais. Dans de nombreux pays d’Afrique, des Balkans et d’Asie centrale, les programmes relatifs à la santé reproductive, à la lutte contre la violence sexiste et à la défense des droits des personnes LGBTQ+ sont menacés, des emplois sont supprimés et des safe spaces sont menacés de disparaître.(32) ONU Femmes prévient que des millions de femmes et de filles pourraient perdre l’accès à des services de santé vitaux dans les mois à venir, tandis que des enquêtes menées auprès d’ONG montrent que les ordres d’arrêt de travail et l’effondrement des partenariats sont monnaie courante. Ces coupes budgétaires ne sont pas neutres : elles encouragent les acteurs autoritaires, légitiment les discours anti-droits et réduisent au silence les voix locales les plus à même de demander des comptes aux États.
Au lieu de réduire les risques, le retrait de l’aide ne fait qu’aggraver les pressions liées à la polycrise : les urgences sanitaires s’intensifient, l’espace civique se réduit et les démocraties fragiles se fragilisent davantage. En sapant les infrastructures féministes et communautaires de soins et de résilience, les gouvernements donateurs accélèrent l’instabilité dans leur propre pays et à l’étranger. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce ne sont pas des solutions ponctuelles, mais des « polysolutions » : des approches de financement et de gouvernance à long terme, fondées sur les droits et inclusives, qui garantissent que les personnes les plus touchées soient au cœur de la conception des réponses.(33) Sans ce changement, la réduction de l’aide ne réduira pas seulement à néant des décennies de progrès, mais elle empêchera aussi la possibilité d’un avenir plus juste et plus résilient.
Les dynamiques décrites dans cet article montrent clairement que le genre n’est pas un sujet secondaire dans cette polycrise, mais qu’il est au cœur de la manière dont ses effets en cascade sont vécus et combattus. Le recul des droits reproductifs, l’érosion des protections accordées aux communautés LGBTQ+ et le retrait de l’aide internationale révèlent précisément les faiblesses structurelles décrites dans la littérature sur la polycrise : une gouvernance cloisonnée, des calculs politiques à court terme et l’exclusion des personnes les plus touchées du processus décisionnel. Il ne s’agit pas d’échecs politiques isolés, mais de symptômes systémiques d’institutions conçues pour des périodes plus simples, et qui peinent à faire face au poids de crises interconnectées.
Pour aller de l’avant, il faut adopter des approches intégrées, fondées sur les droits et axées sur la justice que le cadre des « polysolutions » met clairement en avant. Concrètement, il faut comprendre comment les vulnérabilités liées au genre sont liées aux crises économiques, technologiques et écologiques, investir dans une gouvernance anticipative et dans le renforcement de la résilience, et placer les organisations féministes et de la société civile au cœur de la réponse à la crise plutôt que de les reléguer à la marge. Avant tout, il faut changer de discours, en passant d’une vision d’effondrement inévitable à une vision de possibilités collectives. Si l’équité et l’inclusion ne deviennent pas le fondement des réponses mondiales, le recul des droits continuera d’alimenter l’instabilité. Mais si le genre est reconnu comme un test décisif de la résilience, alors promouvoir l’égalité des genres en pleine crise peut devenir un levier pour construire un avenir plus juste, plus adaptable et plus durable.
Biographie
Spécialiste de la recherche et des données, Chiara Valenti s’intéresse surtout aux conséquences socio-économiques des déplacements et des migrations. Dans ses recherches sur l’humanitaire et le développement, elle utilise des approches sensibles au genre et fondées sur les droits, en veillant à ce que les personnes touchées soient prises en compte. Elle a travaillé avec des organisations internationales, des agences des Nations unies et des ONG en Europe, en Afrique subsaharienne, dans la région Asie-Pacifique et dans la région MENA.
Références
1) Juncker, J-C., Discours sur l’état de l’Union 2016 : Vers une Europe meilleure – Une Europe qui protège, responsabilise et défend, Commission européenne, Strasbourg, 14 septembre 2016.
2) Tooze, A., « Welcome to the World of the Polycrisis », Financial Times, 28 octobre 2022.
3) For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers, Cour suprême du Royaume-Uni, 16 avril 2025.
4) Human Rights Watch, UK: Court Ruling Threatens Trans People, 9 mai 2025, UK: Court Ruling Threatens Trans People (consulté le 30 août 2025)
5) Equality and Human Rights Commission, An iterim update on the practical implications of the UK Supreme Court judgment, 25 avril 2025, An Interim Update on the Practical Implications of the UK Supreme Court Judgment (consulté le 30 août 2025)
6) Triggle, N., « Puberty blockers for under-18s banned indefinitely », BBC News, 11 décembre 2024, Puberty blockers for under-18s banned indefinitely (consulté le 30 août 2025)
7) Connolly, D.J., Meads, C., Wurm, A. et al. « Transphobia in the United Kingdom: a public health crisis. », International Journal for Equity in Health, 28 mai 2025, édition 24, article n° 155, https://doi.org/10.1186/s12939-025-02509-z (consulté le 30 août 2025)
8) Carter, S., « Trump’s efforts to defund Planned Parenthood threatens US healthcare system, study suggests », The Guardian, 13 août 2025, “Trump’s Efforts to Defund Planned Parenthood Threatens US Healthcare System, Study Suggests (consulté le 30 août 2025)
9) Lee, C., « Title X Freeze Widely Threatens Health Care Access », Time Magazine, 11 avril 2025“Title X Freeze Widely Threatens Health Care Access (consulté le 30 août 2025)
10) Johnson, S., « US Destruction of Contraceptives Dneies 1.4m Affrican Women and Girls Lifesaving Care, NGO Says », The Guardian, 6 août 2025, “US Destruction of Contraceptives Denies 1.4m African Women and Girls Lifesaving Care, NGO Says (consulté le 30 août 2025)
11) DiAlesandro, N., « Every Anti-LGBTQ+ Move the Trump Administration Has Made in Its Second Hundred Days », Them, 11 août 2025, Every Anti-LGBTQ+ Move the Trump Administration Has Made in Its Second Hundred Days (consulté le 30 août 2025)
12) Le terme « lois Don’t Say Gay » désigne des lois adoptées dans plusieurs États américains qui limitent ou interdisent les discussions sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre à l’école. À l’origine, il était lié à la loi de Floride de 2022 sur les droits parentaux en matière d’éducation, mais il est désormais utilisé pour décrire plus largement des mesures similaires qui limitent l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans les programmes scolaires, les discussions en classe et les activités périscolaires.
13) tes : Joint Submission to the Universal Periodic Review of the United States of America, Fiftieth Session, 28 mai 2025, Human Rights Violations Against LGBTQ+ Communities in the United States: Joint Submission to the Universal Periodic Review of the United States of America, Fiftieth Session (consulté le 30 août 2025)
14) Joint Economic Committee Democrats, Abortion Bans Harm Women’s Reproductive Freedom ans Cost Our Economy Billions of Dollars, 9 juillet 2024, Abortion Bans Harm Women’s Reproductive Freedom and Cost Our Economy Billions of Dollars (consulté le 30 août 2025)
15) ET Online, « NASA employees asked to implement these massive changes in work communication after Trump’s executive order », The Economic Times, 7 février 2025, NASA Employees Asked to Implement These Massive Changes in Work Communication after Trump’s Executive Order (consulté le 30 août 2025)
16) Joselow, M., Friedman, L., « In Game-Changing Climate Rollback, E.P.A. Aims to Kill a Bedrock Scientific Finding” », The New York Times, 29 juillet 2025.
17) Laville, S., « Leading US economists urge peers to fight Trump’s attack on environment », The Guardian, 20 août 2025, Leading US Economists Urge Peers to Fight Trump’s Attack on Environment (consulté le 30 août 2025)
18) Innovating for the Public Good, Barriers to Benefits : The Decline in Public Trust, août 2025, Barriers to Benefits: The Decline in Public Trust. R&D for Democracy (consulté le 30 août 2025)
19) European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2024: Domain of Violence (consulté le 30 août 2025)
20) Eurostat, Crime Statistics for 2023 (consulté le 30 août 2025)
21) Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024 (consulté le 30 août 2025)
22) Conseil de L’Europe (Division de l’égalité de genre), La cyberviolence à l’égard des femmes, https://www.coe.int/fr/web/cyberviolence/cyberviolence-against-women (consulté le 30 août 2025)
23) Park, K., Ging, D., Murphy, S., McGrath, C., The Impact of the Use of Social Media on Women and Girls, Parlement européen, Bruxelles, mars 2023, The Impact of the Use of Social Media on Women and Girls (consulté le 30 août 2025)
24) Centre for Countering Digital Hate, Social media can be harmful for kids – so what can we do?, 16 mai 2025, Social Media Can Be Harmful for Kids – So What Can We Do? (consulté le 30 août 2025)
25) Kantola, J., Lombardo, E. (eds), Gender and the Economic Crisis in Europe: Politics, Institutions and Intersectionality, London, Palgrave Macmillan, 2017, Gender and the Economic Crisis in Europe: Politics, Institutions and Intersectionality (consulté le 30 août 2025)
26) OCDE, Réductions de l’aide publique au développement : projections de l’OCDE pour 2025 et à court terme, 25 juillet 2025, https://www.oecd.org/fr/publications/reductions-de-l-aide-publique-au-developpement_811056e3-fr.html (consulté le 30 août 2025)
27) Bond, Gender, education and health programmes cut in FCDO’s UK aid allocations for 25/26, 23 juillet 2025, Gender, Education and Health Programmes Cut in FCDO’s UK Aid Allocations for 25/26 (consulté le 30 août 2025)
28) OCDE, Réductions de l’aide publique au développement : projections de l’OCDE pour 2025 et à court terme, 25 juillet 2025, https://www.oecd.org/fr/publications/reductions-de-l-aide-publique-au-developpement_811056e3-fr.html (consulté le 30 août 2025)
29) ILGA World et al., Retreat from development aid continues as more governments announc funding cuts, 11 mars 2025, Retreat from Development Aid Continues as More Governments Announce Funding Cuts (consulté le 30 août 2025)
30) ONU Femmes, La baisse des financements humanitaires menace les droits des femmes : enjeux et solutions, 13 mai 2025, https://www.unwomen.org/fr/articles/article-explicatif/la-baisse-des-financements-humanitaires-menace-les-droits-des-femmes-enjeux-et-solutions (consulté le 30 août 2025)
31) Obrecht, A., Pearson, M., « What New Funding Data Tells Us about Donor Decisions in 2025 », The New Humanitarian, 17 avril 2025, What New Funding Data Tells Us about Donor Decisions in 2025 (consulté le 30 août 2025)
32) Šišić, M., Binışık, D., Beyond the Cuts : How the Defunding Affects Feminist and Civil Society Organizations, Heinrich-Böll-Stiftung, 13 mars 2025, Beyond the Cuts: How the Defunding Affects Feminist and Civil Society Organizations (consulté le 30 août 2025)
33) Schreiber, D., Hassnaoui, S., Weyembergh, A., Brosig, M., Kanifa, K., Tibaingana, A., From Polycrisis to Polysolutions : An Interdisciplinary Aproach to Complex Global Challenges, PolyCIVIS, mars 2025, From Polycrisis to Polysolutions: An Interdisciplinary Approach to Complex Global Challenges (consulté le 30 août 2025)