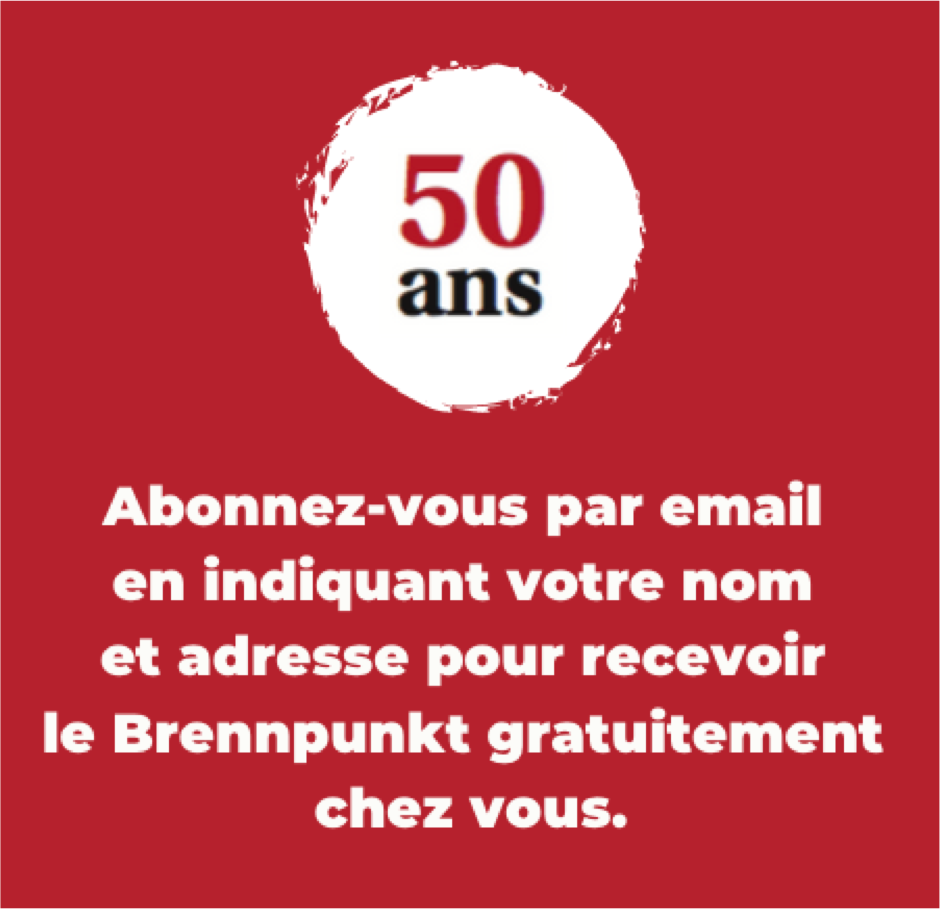Lien vers le texte en langue originale (espagnol)
Ces dernières années, les échanges de dette pour la conservation ou encore dette contre nature ont été promus dans des espaces internationaux tels que les sommets du G20, les Conférences des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) et sur le changement climatique, ainsi que, plus récemment, lors de la IVe Conférence internationale sur le financement du développement (Séville, juillet 2025).
Au sein de ces instances, des responsabilités communes, bien que différenciées, ont été reconnues quant aux causes et aux impacts du changement climatique et de la perte de biodiversité, les pays industrialisés, principalement du Nord, étant identifiés comme les principaux responsables. Or, au lieu d’assumer cette responsabilité et d’affecter les fonds promis à la lutte contre la pollution, à la restauration des écosystèmes et au soutien des communautés impactées, on recourt une fois encore au mécanisme de la dette extérieure érigée en instrument de domination, de contrôle et de profit financier.
Présentés comme des solutions innovantes, les échanges de dette contre nature bénéficient du soutien de la banque multilatérale et de la participation de nombreux intermédiaires financiers : banques internationales, fondations philanthropiques et organisations de conservation des États-Unis et de l’Union européenne, qui portent la Stratégie de finances durables et l’Agenda 30×30(1).
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les deux échanges de dette contre conservation réalisés par l’Équateur aux Galápagos (2023) et en Amazonie (2024)(2). Ces deux accords, négociés dans la plus grande discrétion, ont été présentés comme des avancées permettant de réduire la dette extérieure et de financer la protection de l’environnement. Toutefois une analyse critique révèle un enchevêtrement d’intérêts financiers et corporatifs qui menacent la souveraineté nationale, le contrôle territorial ainsi que les droits des communautés et peuples autochtones.
L’architecture financière et ses acteurs
Les échanges de dette contre conservation répondent à une logique de financiarisation de la nature. Ils impliquent le remplacement d’obligations commerciales par des « obligations nature », émises dans le cadre de nouveaux schémas conçus par les banques d’investissement et approuvées par des organismes multilatéraux. Ces obligations se négocient sur les marchés financiers internationaux, comme ceux de New York et de Londres, ce dernier étant l’un des principaux marchés européens d’obligations vertes.
Dans le cas des Galápagos, l’intermédiaire principal était GPS Blue Financing DAC (véhicule financier enregistré en Irlande), soutenu par le Crédit Suisse et la Bank of New York Mellon. Un montant de 1,63 milliard de dollars US en obligations commerciales a été racheté avec une décote de 40 % de sa valeur, en contrepartie de l’émission de nouvelles obligations pour un montant de 656 millions de dollars US, baptisées « obligations marines des Galápagos » (3). La Banque interaméricaine de développement (BID) a apporté une garantie de 85 millions de dollars US, tandis que la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), agence du gouvernement américain, a octroyé une assurance contre le risque politique et le non-respect d’un arbitrage, pour un montant équivalent au nouveau crédit(4).
Sur les ressources économisées, 450 millions de dollars US doivent être affectés, sur une période de 18 ans, au Galápagos Life Fund (GLF), créé dans l’État du Delaware, aux États-Unis. On estime que sur ce montant, 323 millions de dollars US seront utilisés pour la conservation effective, le reste visant à couvrir les frais d’intermédiation et les commissions.
L’échange de dette en Amazonie repose sur un schéma similaire : la Bank of America a négocié le rachat de 1,52 milliard de dollars US en obligations commerciales pour un montant de 1 milliard de dollars US, financé par Amazon Conservation DAC. Le pays a émis des « obligations Amazonie » à hauteur de ce milliard de dollars, arrivant à échéance en 2042. La Banque interaméricaine de développement (BID) a accordé une garantie de 155 millions de dollars US, tandis que le Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) italien a émis une assurance-crédit, la DFC couvrant le risque politique et l’exécution d’arbitrages siégeant à Londres. Une enveloppe de 460 millions de dollars US sera destinée au Fonds Biocorridor amazonien (5).
Autour de ces acteurs gravitent des fondations philanthropiques (Ledunfly Philanthropy, Pew Bertarelli Ocean Legacy Project), des investisseurs privés (Aqua Blue Investments LLC) et des cabinets de conseil financier, tous ayant des intérêts dans la valorisation et la commercialisation d’actifs naturels. Ces opérations s’inscrivent dans un schéma mondial déjà appliqué aux Seychelles, au Belize, à la Barbade, au Gabon et aux Bahamas, où The Nature Conservancy (TNC) a joué un rôle déterminant dans la gouvernance de vastes zones marines et terrestres(6).
Contrôle territorial et souveraineté
Ocean Financing Company, dans le cas des Galápagos, et TNC, dans celui de l’Amazonie, ont géré et structuré, via leur bras financier NatureVest, le mécanisme des échanges de dette et sont les principaux administrateurs des fonds fiduciaires « indépendants » : le Galápagos Life Fund et le Fonds Biocorridor amazonien. Bien que ces fonds réunissent des représentants de l’État, les décisions stratégiques reviennent aux acteurs externes mentionnés. Ce schéma entre en contradiction avec la Constitution équatorienne, qui confère à l’État la compétence exclusive sur les aires protégées et leur gestion.
Il convient de souligner que ces fonds fiduciaires ont été enregistrés dans des juridictions opaques, comme le Delaware, où les informations financières et sociétaires sont protégées.
Des zones d’une importance majeure pour leur biodiversité et leur rôle dans les cycles naturels – 193 000 km² dans la Réserve marine des Galápagos, 6,4 millions d’hectares de forêts et 18 000 km de cours d’eau en Amazonie – se retrouvent ainsi soumises à l’agenda, aux critères et aux conditionnalités d’entités privées internationales liées à des intérêts financiers, corporatifs et de contrôle territorial(7).
Implications pour les communautés et le pays
Dans le cas des Galápagos, les aires protégées relevant de ce modèle pourraient restreindre l’accès et l’usage traditionnels des moyens de subsistance des populations et communautés côtières, compromettant sérieusement leur souveraineté alimentaire.
En Amazonie, le Programme Biocorridor amazonien couvre des réserves et parcs nationaux emblématiques tels que Yasuní, Cuyabeno, Sumaco et Limoncocha. La subordination de leur gestion à TNC et à ses partenaires financiers porterait atteinte à l’autonomie des peuples autochtones sur leurs territoires ancestraux, et affecterait également les communautés paysannes qui y sont établies(8).
Sous couvert de conservation, ces échanges, sur les marchés verts ou bleus, pourraient ouvrir la voie à des projets à fort impact environnemental : exploitation minière des fonds marins, bioprospection de ressources génétiques, expansion d’infrastructures touristiques, corporatives et énergétiques d’envergure. Ils pourraient également s’accompagner de systèmes de compensation carbone et biodiversité permettant à des entreprises polluantes de « compenser » leurs émissions sans réduire leur impact réel, transformant ainsi le territoire en un actif négociable.
À l’échelle nationale, l’impact est double. D’une part, le pays continue de rembourser la nouvelle dette au prix d’une exploitation accrue de la nature, sacrifiant ainsi des investissements qui pourraient améliorer les conditions de vie de la population. D’autre part, en se perpétuant, la dette extérieure reste utilisée comme un instrument de contrôle géopolitique et économique, portant atteinte à la souveraineté nationale.
Lorsque la biodiversité est financiarisée en tant que mécanisme de conservation, sans remise en cause des modes de production et de consommation, des formes de gestion des écosystèmes, ni de la nécessité d’un nouveau cadre institutionnel mondial susceptible d’équilibrer les relations entre pays et de freiner la destruction de la nature, le résultat ne peut être qu’une aggravation de la crise écologique et climatique et un appauvrissement accru des peuples.
Les échanges de dette contre conservation sont des instruments du capitalisme vert. La transition vers de nouvelles économies passe par l’arrêt du modèle extractiviste, de l’agro-industrie à grande échelle, de la construction de méga-infrastructures et des technologies destructrices, tout en consacrant des fonds à la réparation intégrale des dettes écologiques et climatiques, et en transformant la structure financière internationale, y compris le système d’endettement, sur la base de la justice sociale, économique et écologique.
Découvrez davantage sur le sujet dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Lx4OHfA5_Ec
Références :
- L’Agenda 30 x 30 correspond à l’Accord-cadre mondial pour la biodiversité des Nations unies (2022), dans lequel les gouvernements se sont engagés à protéger 30 % des terres, des eaux douces et des océans de la planète d’ici à 2030.
- Les échanges de dette des Galápagos et de l’Amazonie ont été dominés par des acteurs financiers et politiques des États-Unis, bien que l’Union européenne y joue également un rôle indirect. La banque européenne – tel l’ancien Crédit Suisse, désormais absorbé par l’Union Bank of Switzerland (UBS) – a été un acteur central de ces opérations. L’Espagne, en tant que membre de la Banque interaméricaine de développement (BID), influe sur l’octroi des garanties. À cela s’ajoute le rôle de grandes organisations de conservation basées ou ayant leurs origines en Europe, telles que la Fondation Bertarelli et le WWF, qui participent aux consortiums promouvant ces mécanismes à l’échelle mondiale.
- Ministère de l’Économie et des Finances de l’Équateur. L’Équateur concrétise un échange de dette pour la conservation des Galápagos. Quito, 9 mai 2023. https://www.finanzas.gob.ec
- BID. Garantie de liquidité de crédit pour les obligations marines des Galápagos. Washington, 2023. – DFC. Political Risk Insurance for Ecuador Debt-for-Nature Swap. 2023.
- https://www.accionecologica.org/3-que-hay-detras-del-canje-de-deuda-por-amazonia/
- https://www.accionecologica.org/galapagos-canje-de-deuda-por-conservacion-o-cuidado-de-la-vida/
- https://www.youtube.com/watch?v=Lx4OHfA5_Ec