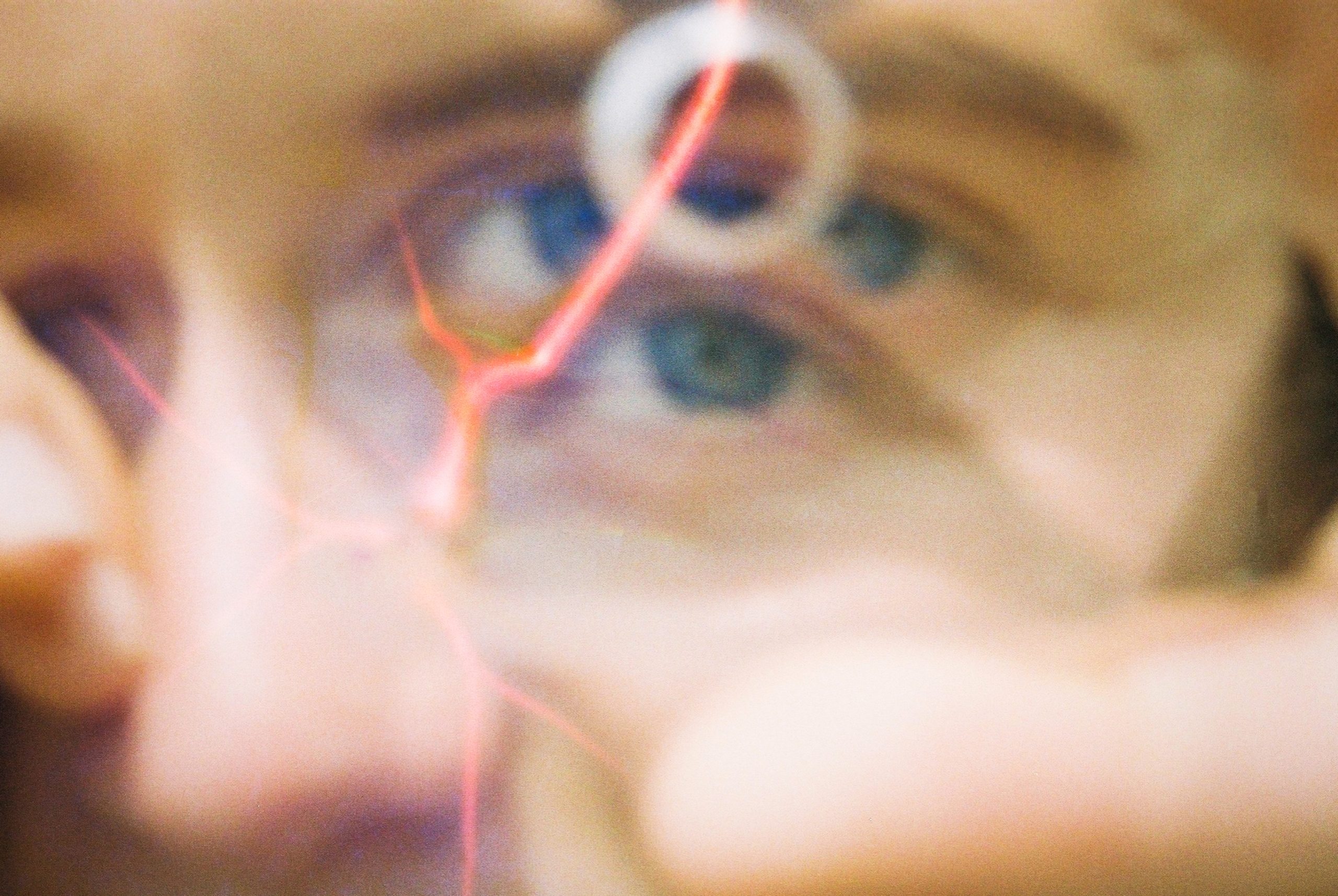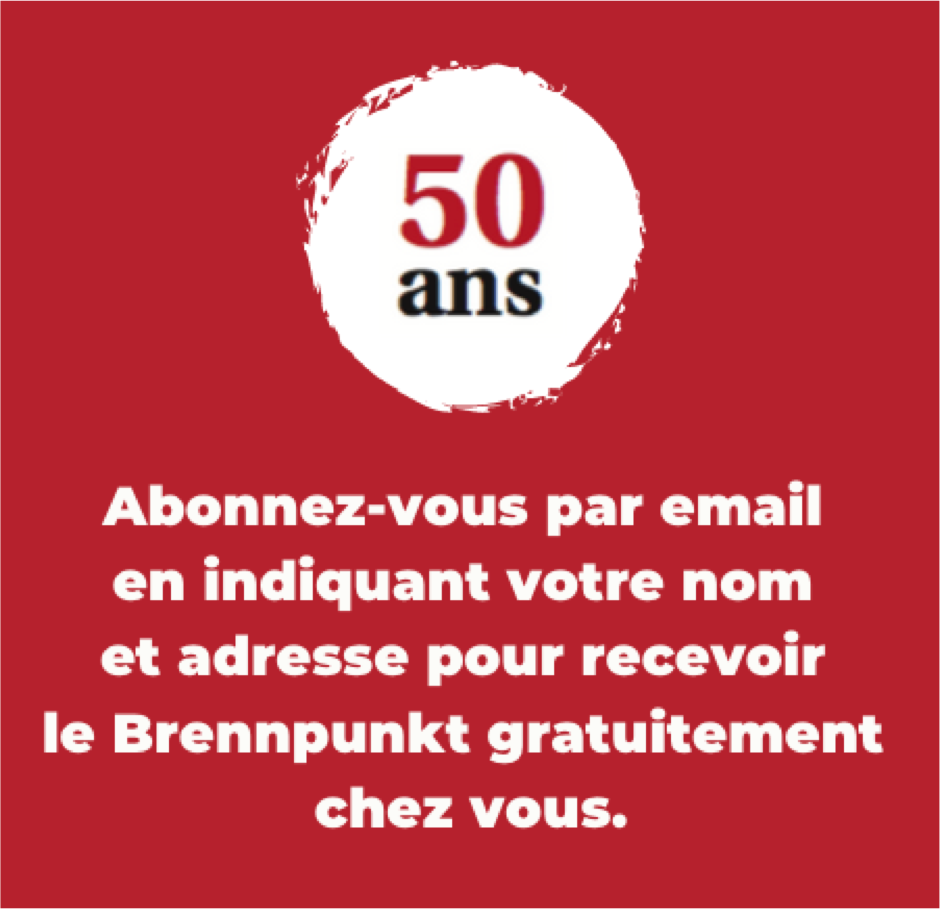Avez-vous la main tranquille ? Nous recrutons des pollinisateur·ice·s humain·e·s ! », annonce la publicité d’une d’une marque allemande de jus de fruits sur laquelle je tombe en ouvrant un magazine offert dans un magasin bio. J’ai failli avaler mon café de travers ; je ne sais pas si j’ai envie de pleurer ou d’éclater de rire. Plus tard, je découvre qu’il s’agit d’un poisson d’avril. N’empêche : le coup est réussi. C’est si proche de la réalité que la blague laisse un arrière-goût amer. D’ici peu, ce genre d’annonces ne sera peut-être plus une plaisanterie.
Ceci n’est qu’une des confrontations quotidiennes avec la fin du monde que je connais. Les signes annonciateurs sont partout : des oiseaux morts par dizaines sur les routes que je sillonne à vélo, la pluie de cendres tombée un jour d’incendie au centre de Marseille, des arbres sans feuilles en plein mois d’août autour de mon Stauséi bien aimé, et puis tous ces reportages sur des vies humaines brisées par les crises écologiques et les guerres.
Une question me hante : comment font les autres pour ne pas voir ? Et s’ils voient, comment font-ils pour ne pas être affectés ? Et s’ils sont affectés, pourquoi restent-ils dans l’inaction ? Quand on prend conscience de la polycrise et de l’ampleur des changements qu’elle impose, plusieurs réactions sont possibles : nier, se replier, sombrer dans la déprime. Ou bien essayer de vivre en accord avec ses valeurs, voire s’engager dans la lutte systémique.
Beaucoup choisissent la négation, y compris parmi les jeunes. Je les comprends : c’est plus facile. Plus simple que de remettre en cause ses habitudes, plus rassurant que d’affronter l’angoisse existentielle. Si la viande industrielle espagnole coûte moins cher que les légumes bio locaux, si l’avion est plus abordable que le train, si le vélo est plus dangereux que la voiture, si un job en marketing est mieux payé qu’un métier du secteur des soins, si la devise du bonheur luxembourgeois reste « maison, voiture, consommation », comment leur reprocher leur inaction ? D’où viendrait le courage de s’opposer à l’optimisation individualiste que la pensée néolibérale nous impose en permanence ?
Être jeune au début du 21e siècle, c’est grandir dans un monde instable. Pas seulement au niveau international, mais aussi au quotidien ; beaucoup n’ont plus de repères. Parents absents, activités sociales qui disparaissent, refuge facile des réseaux sociaux. Dans ce contexte, difficile de remettre en cause les quelques piliers qui tiennent encore debout — consommation, individualisme, technosolutionnisme.
Et pourtant, beaucoup de jeunes que je rencontre se soucient profondément des crises actuelles, notamment de la crise écologique. Mais ils ne croient plus en la politique, ni en la démocratie telle qu’elle est pratiquée en ce moment. Certain·e·s se retournent alors contre le « système » et inventent des alternatives : communautés autogérées, collectifs militants, modes de vie en marge. Encore une fois, c’est compréhensible : croire que les politiques vont agir vite paraît irréaliste, et militer use énormément, surtout quand les échecs s’enchaînent. Mais que reste-t-il, sinon d’essayer de changer les systèmes déjà en place, faute de mieux ? Pour ce faire, il nous faudrait un sentiment d’appartenance, un mythe collectif qui nous lie les uns aux autres(1).
Sur le papier, les Objectifs de développement durable (ODD) pourraient être le cap dont l’humanité a besoin face à la polycrise : une feuille de route claire, signée par presque tous les États. Mais leur naissance « par le haut » — conçue comme une réponse politique aux mobilisations écologiques et sociales plutôt que comme un projet citoyen — les condamne, pour beaucoup, à n’être qu’un exercice de greenwashing institutionnel. Les affiches colorées masquent mal la continuité du business as usual. Comment croire en un récit commun quand ceux qui l’ont écrit ne changent pas leurs priorités ? Tant que les ODD ne passeront pas avant les intérêts économiques et géopolitiques, ils ne seront rien d’autre qu’un catalogue d’intentions creuses.
Derrière cela se cache une interrogation plus large sur la coopération internationale. Sans doute, elle est indispensable : aucune crise globale — climatique, sanitaire, géopolitique — ne peut être résolue sans coopération entre États. Pourtant, ses succès sont rares. La lutte réussie contre le trou dans la couche d’ozone reste l’exception souvent citée, mais ce problème était moins lié à nos habitudes profondes. À l’inverse, les solutions qui fonctionnent sont souvent locales, portées par des communautés ou des projets de terrain. Alors pourquoi les États se désengagent-ils de plus en plus du soutien à ces initiatives, notamment celles des peuples autochtones qui savent depuis longtemps comment vivre dans les limites planétaires ?
Cette contradiction me traverse aussi. J’ai grandi avec la certitude que la crise écologique marquerait le siècle et ma génération. Mes choix d’études et de travail ont été guidés par une question : comment puis-je être la plus utile pour contribuer au changement nécessaire ? Ce sentiment de responsabilité individuelle m’accompagne souvent. Mais est- il moralement justifié ? Qui serais-je devenue sans cette crise ? Aurais-je étudié
l’urbanisme, appris la menuiserie, ouvert un restaurant ?
Bien sûr, l’incertitude n’est pas nouvelle. Mes grands-parents aussi ont grandi dans l’ombre de crises majeures : la guerre, la menace nucléaire, le chômage de masse. Le futur a toujours été fragile, et aucune génération n’a pu avancer sans doutes ni peurs. Mais il y a une différence fondamentale. Hier, l’incertitude portait surtout sur la forme que prendrait l’avenir : guerre ou paix, prospérité ou misère, liberté ou dictature. Aujourd’hui, c’est la possibilité même d’un futur qui vacille. Car ce n’est plus seulement l’Homme qui menace l’Homme : ce sont les écosystèmes eux-mêmes, rendus instables par nos excès, qui remettent en question la survie des générations à venir. La bascule de l’incertitude du « comment » à celle du « si » ouvre de nouveaux gouffres.
En même temps, nous faisons face à une abondance d’options inédites : d’études, de carrières, de modes de vie. Une chance immense, j’en suis consciente, puisque mes besoins de base sont couverts. Mais ce privilège se retourne parfois en anxiété. Quand tout semble possible, plus rien ne sert de boussole. L’écologie, pourtant essentielle, devient alors pour beaucoup un choix parmi d’autres, comme si elle n’était pas la condition préalable de tout le reste.
Vu la facilité de croire dans les bienfaits du néolibéralisme individualiste, les grands récits collectifs, comme les ODD, peinent à nous fédérer. Surtout que la coopération internationale reste balbutiante et que les horizons politiques se dérobent chaque jour un peu plus.
Mais peut-être faut-il chercher ailleurs. Camus écrivait que Sisyphe pouvait être heureux malgré l’absurde, parce que le bonheur n’est pas dans la certitude du sommet, mais dans l’acte même de « pousser la pierre » (2). Au Luxembourg, où le coût de la vie étouffe les classes populaires, la transition écologique se heurte à une autre réalité : celle des travailleurs précaires, des familles endettées, des jeunes sans logement stable. La crise n’est pas seulement environnementale, elle est aussi une crise de la redistribution, de l’accès aux ressources, de la dignité.
Pourtant, nous avons une chance : celle de refuser la résignation. Salomé Saqué, dans Résister, écrit que le courage consiste à ne pas céder au silence, à ne pas accepter l’assimilation. Résister, c’est aussi lier les combats : justice climatique et justice sociale.
Alors non, je ne crois pas aux miracles collectifs. Mais je crois à la résistance quotidienne. Résister en posant des questions. Résister en refusant les évidences toutes faites. Résister en renonçant à l’individualisme, en cherchant de nouvelles façons de vivre. Et surtout, résister en trouvant aussi du bonheur dans ce refus : dans les amitiés construites autour de ces valeurs, dans le temps dégagé par le refus du consumérisme (4), dans la dignité d’espérer malgré tout.
Parce qu’au fond, même si je ne sais pas ce que sera demain, je sais une chose : je veux essayer, pas me résigner, m’indigner, pas me taire, agir, pas subir. Encore et encore.
Claire Faber, née en 1997, a fait des études en sciences politiques de l’environnement. Elle vit à Marseille et travaille dans l’adaptation au changement climatique.
Références :
1) Harari, Y. N., Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, Paris, 2015.
2) Camus, A., Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris, 1942.
3) Saqué, S., Résister : Enquête sur un malaise démocratique, Payot, Paris, 2022.
4) Klent, H., Paresse pour tous, Le Tripode, Paris, 2021.